Juillet 2024 au Sens de l’Humus
clairesistach, 30/06/2024 | Source: Le sens de l'humus
clairesistach, 30/06/2024 | Source: Le sens de l'humus
giuliaherzenstein, 19/06/2024 | Source: Le sens de l'humus
Christophe Curci, 17/06/2024 | Source: PermacultureDesign
La tonte de votre pelouse est une corvée pour vous ? Un vrai calvaire du week-end qui prend beaucoup trop de temps ?
Alors, la tonte différenciée devrait beaucoup vous plaire !
En plus, vous allez découvrir qu’elle comporte énormément d’avantages pour vous, mais aussi pour la nature en favorisant la biodiversité.
On vous explique tout ça dans cet article et sa vidéo.
Et comme on est sympa 😉, nous allons aussi vous donner des astuces de tonte pour être encore plus efficace dans vos actions.
La tonte différenciée va définitivement vous réconcilier avec votre pelouse, et, en plus, la nature vous dira merci.
Cette manière de tondre s’adresse absolument à tout le monde !
Que vous ayez un petit ou un grand jardin, ou que vous soyez un gestionnaire d’espaces verts pour des collectivités ou des entreprises, vous allez regretter de ne pas avoir connu cette pratique plus tôt 😃.
Allez, c’est parti pour la découverte de cette pratique vertueuse à mettre en œuvre de suite après la lecture de cet article.
Comme souvent, au bureau d’études, on aime bien savoir de quoi on parle exactement.
En effet, vous entendrez parfois parler de tonte différenciée ou de tonte raisonnée.
Il s’agit bien de deux appellations d’une même pratique.
On l’appelle aussi parfois, à tort, fauchage tardif.
Le fauchage tardif est une pratique différente, mais très complémentaire à la tonte différenciée, c’est pourquoi on les confond souvent.
Nous vous expliquons plus précisément, en fin d’article, en quoi consiste exactement le fauchage tardif, quand et comment le faire.
Il y a donc principalement deux appellations, tonte différenciée et tonte raisonnée, pour décrire ce que nous allons vous expliquer ici en détail.
Découvrons ensemble cette pratique novatrice et économe en énergie pour la gestion de vos pelouses.

Cette méthode se distingue de la tonte traditionnelle qui prône un entretien uniforme de la pelouse.
Au lieu de tondre chaque brin d’herbe à la même hauteur, vous allez créer des zones où la végétation pousse librement et d’autres qui seront tondues.
Le choix des parties tondues ou laissées libres se fait en fonction de leurs natures et usages.
Les parties tondues sont généralement des zones de passage ou de fréquentation régulière comme les aires de jeux, de repas ou les bords de mare…
Nous verrons plus tard comment les définir.
L’entièreté de la surface de pelouse de votre jardin est tondue à la même hauteur.
Pas de place pour la moindre herbe sauvage et rien ne doit dépasser nulle part 😓, l’uniformité règne, la diversité a entièrement disparu du jardin.

Seule une partie de la pelouse est tondue, le reste est laissé libre et sera fauché une seule fois dans l’année.

La tonte différenciée permet donc de laisser la Nature et sa diversité s’exprimer dans votre jardin.


La tonte différenciée utilise les principes de permaculture, comme « favoriser la biodiversité ». Pour un projet de jardin en permaculture résilient et durable, faire son design est une étape incontournable à sa réussite.
Apprenez à faire cette conception de façon efficace et à votre rythme grâce à notre formation en ligne dédiée qui vous guidera pas à pas et s’adaptera à vos objectifs et votre contexte unique !
En adoptant la tonte différenciée, vous avez beaucoup moins de surface à tondre, cela se fait donc plus rapidement et en se fatiguant moins !
Et cela fait plus de temps pour vos loisirs en famille ;).

Tondre de plus petites surfaces va vous faire faire de nombreuses économies :
Moins de surfaces à tondre, c’est également une réduction significative des nuisances sonores associées à la tonte avec un engin à moteur thermique.
Le chant des oiseaux est tellement plus agréable !
Votre famille et vos voisins profiteront donc eux aussi de votre passage à la tonte raisonnée !
En laissant des espaces non tondus, libres de se développer sans intervention de votre part, vous laissez la nature reprendre ses droits, une bonne partie de l’année, sur ces petits espaces.
Et vous verrez que très vite, ces zones vont foisonner de vie et de diversité, tant au niveau de la flore que de la faune.
Si vous prenez le temps de vous poser en face d’une de ces zones non tondues, avec vos enfants par exemple, et que vous observez ce qui s’y joue, cela peut être très réjouissant, pédagogique et stimulant pour l’imaginaire et la créativité.
Amusez-vous, par exemple, à compter les différentes plantes que vous voyez ou les différents insectes qui s’y trouvent ou la visitent… vous n’êtes pas au bout de vos surprises, car la nature et sa biodiversité sont toujours étonnantes pour qui se donne le temps de les regarder.
Ces moments d’observation seront aussi un moyen de vous reconnecter à la nature et d’imaginer d’incroyables aventures au cœur de votre jardin.

Qui dit zone non tondue, dit hauteur d’herbe conséquente.
Or cela a un gros impact sur les besoins en eau de l’ensemble de votre jardin.
En effet, l’herbe haute va maintenir l’humidité du sol et limiter l’évapotranspiration.
Cela se traduira par une réduction importante des besoins en arrosage sur votre lieu.
Si vous arrosez à l’eau de ville, ce sera une économie financière de plus faite grâce à la tonte différenciée 😉.
Les sols aussi tirent plusieurs avantages de cette pratique vertueuse qu’est la tonte raisonnée.
Ils deviennent plus riches et plus vivants, car, les zones non tondues contribuent à :
De tout temps, la nature a inspiré les plus grands artistes par sa beauté sauvage.
En pratiquant la tonte différenciée, vous laissez à la Nature des espaces d’expressions dans votre jardin qui retrouve avec elle, une esthétique naturelle remarquable, d’une diversité réjouissante, plus de volumes, plus de couleurs !
Ça change du green de golf vert uni, ras et monotone.
L’aspect esthétique reste évidemment subjectif, certains ne seront donc pas de notre avis.
Mais retrouver une esthétique naturelle au jardin reste, pour nous, une excellente raison de passer à la tonte raisonnée, surtout s’il y a des artistes en herbe à la maison 🤩.

En faisant vos choix de zones à tondre pour la tonte différenciée, vous allez voir votre terrain sous un nouvel angle en mettant en évidence des zones intéressantes.
Cela va vous inspirer et sûrement vous donner de nouvelles idées d’aménagement ou d’installation sur ces nouvelles zones : ici des fleurs, un nouvel arbre fruitier ou ornemental, là une haie gourmande de petits fruits ou un potager de légumes perpétuels, etc.
Cela va donc transformer votre jardin !
Le design, c’est la conception en permaculture d’un terrain, inspirée par la nature, pour répondre à des objectifs dans un contexte particulier.
Ce travail se fait en plusieurs étapes qui permettent d’aboutir à un plan sur le papier.
De ce plan découle une feuille de route avec les aménagements et installations concrètes à mettre en œuvre sur le terrain sur les années qui suivent.
Si vous voulez être guidé(e) pas à pas dans cette conception (design) de votre lieu, faites confiance à notre formation en ligne « Invitez la permaculture dans votre jardin ! », à découvrir en cliquant sur le lien ci-dessous.


La tonte différenciée utilise les principes de permaculture, comme « favoriser la biodiversité ». Pour un projet de jardin en permaculture résilient et durable, faire son design est une étape incontournable à sa réussite.
Apprenez à faire cette conception de façon efficace et à votre rythme grâce à notre formation en ligne dédiée qui vous guidera pas à pas et s’adaptera à vos objectifs et votre contexte unique !
Or la tonte différenciée permet, sur le terrain, de repérer les zones avant d’aller plus loin et de planter, installer des clôtures, etc.
Elle permet donc d’expérimenter, grandeur nature, la disposition de vos différents espaces, la façon de vous déplacer de l’un à l’autre, les surfaces occupées par telle ou telle zone…
Vous voyez ainsi sur le terrain si, ce que vous aviez prévu sur le papier vous convient réellement ou si des ajustements voire des corrections sont nécessaires (agrandir ou réduire une zone, la déplacer ou la rapprocher d’une autre, élargir un chemin, etc.).
La tonte raisonnée vous aide donc à affiner votre design pour qu’il réponde au mieux à vos attentes sur le terrain.

Pour pouvoir mettre en pratique correctement la tonte raisonnée ou différenciée, il vous faudra définir vos zones de tontes.
Il y a 4 grands types de zones à définir chez vous.
Ces zones de loisirs seront aussi diverses que vous.
Ce sont des surfaces relativement grandes dédiées à une activité.
Il peut s’agir de :

Vous avez peut-être constaté que, même lorsque l’ensemble de votre terrain était tondu impeccablement, il y avait des cheminements récurrents que vous empruntiez tout naturellement, sans vous poser de question que ce soit pour aller de la terrasse à l’étendoir à linge, de la cuisine au potager ou du potager au poulailler…
Pour pratiquer la tonte différenciée, vous allez devoir choisir quels cheminements vous avez réellement envie de créer et maintenir sur votre terrain.

Vous devrez également définir leur rôle et pour quels usages ils vous sont nécessaires.
Cela vous permettra ensuite de choisir leur tracé et leur largeur…
Pour ce qui est de la largeur, on peut s’appuyer sur la largeur de sa tondeuse.
Selon la fréquentation du chemin (emprunté tous les jours ou moins souvent) ou son usage (déambulation à plusieurs, passage où on aura les bras chargés…), il fera d’une à plusieurs largeurs de tondeuse comme illustré ci-dessous.

Ce choix de vos zones de cheminements et passages est très stimulant à faire.
Tous les éléments dont vous voulez faire le tour ou auxquels vous souhaitez pouvoir accéder facilement doivent avoir leurs abords directs bien dégagés.
On pense ici notamment au potager, au bord de votre mare ou encore tout autour du fil à étendre le linge.
Ces zones seront à inclure dans votre plan de tonte différenciée.

Pour des raisons de bon voisinage, vous aurez peut-être aussi des « bandes de propreté » à maintenir bien tondues en bordure de votre terrain, là où celui-ci jouxte le terrain des voisins sans autre séparation qu’un grillage par exemple.
En effet, beaucoup de gens voient encore d’un mauvais œil les terrains qui ne sont pas entièrement tondus à ras.
Ils considèrent ça comme un manque d’entretien, un espace « sale » où il peut y avoir toutes sortes de bestioles effrayantes ou « mauvaises herbes » prêtes à envahir leur jardin…
Ces peurs génèrent des exigences de « faire propre » exagérées et hélas, destructrices pour la biodiversité.
Les discussions à ce sujet pouvant vite s’envenimer ou devenir interminables, autant vous épargner cette peine et dégager une « bande de propreté » d’une à plusieurs largeurs de tondeuse sur toutes les zones limitrophes pouvant poser problème.
Les bandes de propreté, en bordure de terrain ou de maison, peuvent aussi être exigées par certaines communes ou lotissements pour des raisons de sécurité (limiter les risques d’incendie par exemple).
Il sera important de bien localiser ces zones pour les inclure dans votre tonte raisonnée.

Maintenant que vous avez bien compris ce qu’est la tonte différenciée et choisi les zones qui seront réellement à tondre chez vous, voici quelques petites astuces pour vous faciliter la vie et être aussi plus efficace dans vos actions sur le terrain.
À quelle hauteur de coupe régler votre tondeuse ?
En été, on coupera un peu moins bas qu’au printemps ou à l’automne afin de limiter les arrosages et favoriser un peu plus la biodiversité.
On ajustera donc la hauteur de coupe de la tondeuse selon la saison.

Ce sera beaucoup plus facile de manier la tondeuse pour créer et entretenir un chemin courbe plutôt qu’un chemin à angle droit…
Cette astuce s’applique sur les zones de loisirs, c’est-à-dire pour des surfaces relativement grandes.
Elle est fondamentale pour préserver un maximum d’espèces animales et d’insectes.
Elle est simplissime, il suffit d’y penser et la mettre en pratique : toujours tondre un espace du centre de celui-ci vers l’extérieur et non l’inverse.

Cela permet, en effet, à un plus grand nombre de petits habitants de fuir vers l’extérieur de la zone à tondre sans rencontrer les lames tueuses de votre tondeuse !
Ça a l’air de rien, mais ça change beaucoup de choses pour la biodiversité.
Pensez-y !

Comme la tonte différenciée, le fauchage tardif favorise la biodiversité et contribue à préserver l’écosystème.
Son principe est simple : laisser les plantes sauvages faire leur cycle complet jusqu’à la graine.
Elles restent donc présentes plus longtemps dans l’environnement, structurent bien le sol avec leur racine, favorisent l’infiltration des pluies et conservent bien l’humidité en cas de fortes chaleurs.
En faisant leur cycle complet, elles passent également par plusieurs stades (jeunes pousses, fleurs, fruits/graines) qui contribuent, chacun à leur manière, à nourrir ou servir de refuge à une grande diversité d’insectes ou d’animaux.
Et laisser grainer ces plantes sauvages permet en plus le renouvellement annuel de la prairie en maintenant la diversité de cette flore (fleurs, graminées, etc.) et donc aussi la diversité des insectes dont le cycle de vie est lié à ces plantes « hôtes ».

Il se réalise une seule fois dans l’année.
La période idéale est la fin d’été ou le début de l’automne.
On le réalise, en général, sur toutes les surfaces qu’on aurait normalement tondues si on n’avait pas choisi de mettre en place cette méthode du fauchage tardif.
Si on ne fauche pas ces zones au moins 1 fois par an, elles vont redevenir vraiment sauvages et évoluer vers la forêt qui est le stade ultime, le « climax » de la succession écologique en climat tempéré.
Ces zones vont donc peu à peu voir se développer des espèces végétales ligneuses, des arbustes pionniers jusqu’aux grands arbres de forêt.

C’est pour éviter cette succession écologique naturelle sur ces zones qu’on souhaite garder ouvertes, qu’on pratique le fauchage tardif.
La tonte différenciée :
Alors, n’attendez plus pour la mettre en oeuvre chez vous et en parler autour de vous pour inciter un maximum de monde à adopter cette pratique géniale pour nous mais aussi pour la planète !!

L’article Tonte différenciée, ou l’art de ne (presque) plus tondre sa pelouse ! est apparu en premier sur Permaculture Design.
Permaculture Design, 17/06/2024 | Source: PermacultureDesign
Avant de parler de jardin en permaculture, rappelons que la permaculture est bien plus qu’une nouvelle approche du jardinage biologique.
Avec sa médiatisation actuelle, elle est hélas trop souvent réduite à des techniques de jardinage et ce n’est vraiment pas lui rendre justice !
Nous souhaitons donc ici lui redonner ses lettres de noblesse, car la permaculture est un concept global génial induisant une véritable philosophie de vie où animaux, insectes, êtres humains, plantes et micro-organismes vivent en harmonie dans un environnement sain, résilient et le plus autonome possible.
Le mot « permaculture » en lui-même est la contraction de « (agri) culture permanente ».
Il fut inventé par Bill Mollison et David Holmgren dans les années 1970.
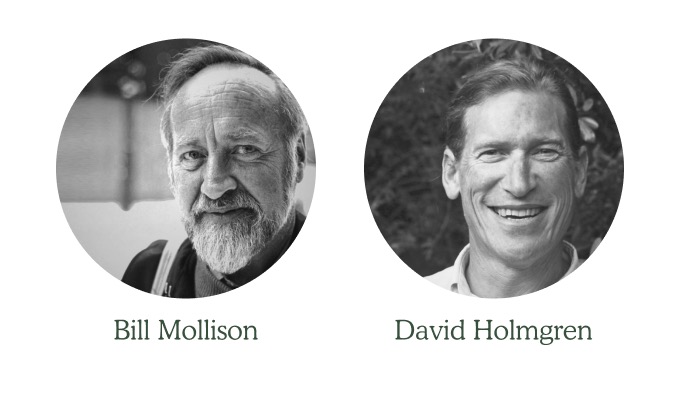
Il regroupe des principes et des techniques d’aménagement et de culture, à la fois ancestraux et novateurs, dans un concept global, dont la mise en œuvre se fait grâce à un outil incroyablement efficace : le design de permaculture.
Le design ou conception en permaculture vise à faire de son lieu de vie un écosystème harmonieux, productif, autonome, naturellement régénéré et respectueux de la nature et de TOUS ses habitants !
Beau programme, non ?
Pour synthétiser cela, voici une définition simple de la permaculture selon Bill Mollison lui-même :
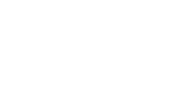

La permaculture est une démarche de conception éthique visant à construire des habitats humains durables en imitant le fonctionnement de la nature.
— Bill Mollison


Pour un projet en permaculture résilient et durable, qu’il soit professionnel ou non, faire son design est une étape incontournable à sa réussite.
Apprenez à faire cette conception de façon efficace et à votre rythme grâce à notre formation en ligne dédiée qui vous guidera pas à pas et s’adaptera à vos objectifs et votre contexte unique !
Mais de quoi est fait ce concept de permaculture, cette démarche inspirante à même de transformer des déserts en oasis de vie verdoyants ?
Voyons de quoi elle est constituée.
La permaculture, telle qu’elle a été réfléchie par ses fondateurs, repose sur 3 piliers essentiels à comprendre et à bien intégrer pour l’appréhender correctement :
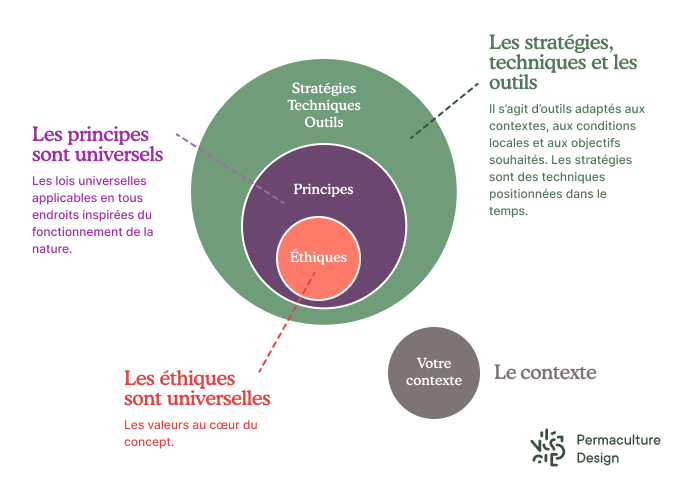
Tout d’abord, il nous semble essentiel de vous parler des éthiques qui sont au cœur de cette démarche globale de permaculture et en font sa force.
La permaculture repose donc sur trois éthiques fondamentales :
Ces trois éthiques sont universelles, c’est-à-dire qu’elles seront les mêmes pour tout projet en permaculture, où que l’on soit sur la planète.
Elles permettent d’avoir une ligne de conduite comportementale et morale, indispensable pour tempérer les égoïsmes instinctifs et encadrer nos actions au quotidien.
Elles créent un cadre pour le « vivre ensemble » et la durabilité.
L’expression « prendre soin de » qu’on entend souvent pour décrire ces éthiques de permaculture place la permacultrice ou le permaculteur dans un rôle interventionniste, mais la terre a-t-elle besoin de nous ? L’humain a-t-il besoin de nous ?
C’est une question de regard sur les choses que nous préférons nuancer avec la formulation « être attentif à » qui nous place davantage dans une position d’observation et d’écoute.
Pour définir les limites et contenus de ces éthiques, Bill Mollison et David Holmgren, les deux co-fondateurs de la permaculture, ont énoncé, chacun à leur manière, divers principes universels sur lesquels s’appuyer pour nous aider à régénérer les écosystèmes naturels à l’échelle de nos designs et à rendre nos projets en permaculture efficaces et résilients.

Vous trouverez donc des formulations assez diverses de ces principes ainsi qu’un nombre de principes variables selon qu’on se base sur ceux énoncés par Bill Mollison et/ou par David Holmgren.
Pour notre part, nous avons fédéré ces divers principes que nous classons en trois catégories :
Voyons maintenant les principes de permaculture en eux-mêmes classés via nos catégories :
Les principes de permaculture basiques
Les principes de permaculture philosophiques

Les principes de permaculture liés au design

Il s’agit de la partie de la permaculture qui est la plus mise en lumière, celle à laquelle, on la réduit trop souvent.
On pense notamment aux diverses techniques de paillage ou de culture sur buttes, aux jardins en trou de serrure, aux spirales aromatiques et autres buttes en lasagnes…

Seulement voilà, quand on voit en vidéo ou qu’on lit un article sur telle ou telle technique de permaculture miraculeuse chez un tel, il y a une nuance fondamentale qu’il ne faut pas perdre de vue.
À la différence des éthiques et principes, les stratégies, techniques et outils en permaculture ne sont pas universels, mais bien contextuels.
⚠️ Et cette nuance essentielle fait toute la différence !
Nous ne comptons plus les fois où nous avons reçu des messages de personnes nous disant que la permaculture ne fonctionnait pas chez eux, car ils avaient tout bien fait comme dans la vidéo pour installer leur butte de permaculture, mais avaient eu des résultats pitoyables…
Ces échecs relatifs, mais hélas souvent décourageants quand on débute, viennent dans leur très grande majorité de l’application de techniques non adaptées au contexte unique des personnes.
Vous comprendrez que nous ne pourrons pas vous détailler ici l’ensemble des stratégies, techniques et outils de permaculture vu la diversité existante, sans compter tout ce qu’on n’a pas encore inventé…
La permaculture est, en effet, inclusive et ouverte aux nouvelles expérimentations stratégiques et techniques !
Nous vous donnerons quand même quelques exemples de stratégies et techniques en permaculture un peu plus bas dans cet article 😉 !
Comme pour tout, on peut trouver des inconvénients à la permaculture.
Pour notre équipe, c’est un concept génial dont on voit surtout les avantages et atouts pour faire transiter notre société vers des modes de vie plus durables.
Cependant, la permaculture reste quand même difficile à appréhender et à appliquer concrètement pour plusieurs raisons.
Ces inconvénients sont donc plutôt à nos yeux des obstacles à franchir, plus que de réels inconvénients.
Le concept de permaculture est pétri de bon sens et de logique.
Une grande part de celui-ci est donc tout à fait assimilable simplement sans connaissances particulières, car cela « coule de source ».
Cependant, la permaculture nécessite également beaucoup de connaissances dans des domaines très divers pour bien comprendre son environnement et ensuite pouvoir faire les bons choix de stratégies, techniques et outils.
C’est souvent là que le bât blesse.
Ce concept de permaculture n’est pas applicable en un claquement de doigts ou d’un coup de baguette magique !
Il faut acquérir un minimum de connaissances sur le sol, la vie du sol, l’eau, les plantes, les insectes, les animaux, les influences du climat et des microclimats… pour ensuite faire des choix pertinents.
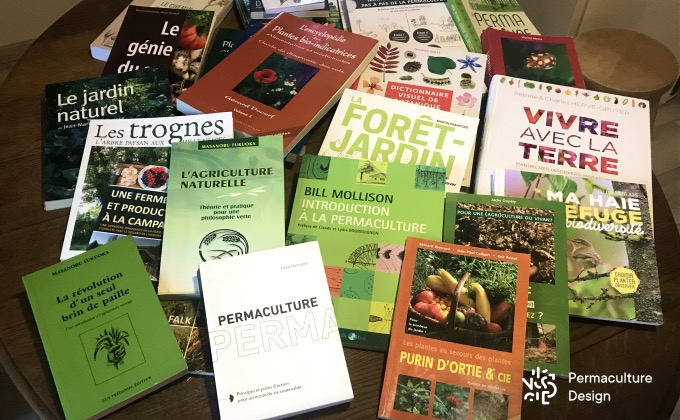
C’est pourquoi, quand on débute en permaculture et qu’on n’a pas ce type de bagages, le passage par un minimum de formations et de lectures de livres sur la permaculture est bien souvent indispensable pour parvenir ensuite à réellement faire son jardin en permaculture.
Dans nos sociétés dites « modernes », nous avons été, au fil du temps, de plus en plus déconnectés de la nature.
Résultats, on ne sait plus lire le paysage comme pouvaient le faire nos anciens et on ne sait plus observer la nature, car on ne nous l’a pas appris.
Or, la permaculture puise sa force de l’imitation de la nature dont la résilience et l’efficacité sont sans pareil.
Pour parvenir à l’imiter au mieux afin de servir nos objectifs et répondre à nos besoins humains fondamentaux, nous devons donc réapprendre à l’observer, dans son ensemble comme dans la multitude de détails qu’elle offre à nos yeux.
Cela est donc un frein important à la pratique de la permaculture pour beaucoup de personnes qui se sentent trop éloignées de la nature et de sa compréhension.


C’est possible grâce au micro jardin-forêt productif même sur un petit espace…
Cependant, nous aimerions rassurer tous celles et ceux qui se sentiraient dans ce cas !
L’observation de la nature est tellement passionnante et source de bien-être que, même en partant de zéro, avec un peu d’aide pour savoir comment et sur quoi porter son attention, on peut très vite acquérir les réflexes d’une bonne observation et la capacité d’interpréter correctement ses observations pour en déduire des choix stratégiques pertinents.
À l’heure où on a pris l’habitude d’obtenir ce qu’on désire en 2 ou 3 clics, où tout doit aller toujours plus vite, il n’est pas facile de se retrouver confronté au temps de la nature qui n’est pas du tout le même que le nôtre.
Par exemple, quand on plante des arbres fruitiers avec l’idée qu’on pourra se régaler bientôt de leurs délicieux fruits, il faut accepter que l’arbre, lui, ait besoin de plusieurs années d’implantation pour être en mesure de porter des fruits (3 à 5 ans en moyenne, mais cela peut aller jusqu’à 10 à 15 ans voire plus sur certaines essences) !

Même si, en permaculture, on va user de stratégies notamment pour « accélérer la succession écologique » ou « obtenir une récolte » le plus vite possible, nous restons quand même en grande partie soumis au temps de la nature qui impose son rythme au fil des saisons.
Bref, quand on se lance en permaculture, mieux vaut changer son rapport au temps et travailler sur sa patience pour réussir à « Privilégier les solutions lentes ».
Une des difficultés à bien cerner la permaculture vient notamment du fait qu’elle peut s’appliquer à tous les domaines de la vie et non pas uniquement au jardin !
Le jardin, l’habitat, l’énergie, la communauté, l’organisation, l’humain… elle touche tellement de domaines différents qu’elle apparait souvent comme une idée floue, un patchwork un peu fouillis ou encore un fourre-tout incompréhensible !
C’est pourquoi, pour y voir plus clair, il est important de revenir aux fondamentaux du concept que nous avons décrit précédemment à savoir les éthiques, les principes, les stratégies, techniques et outils.
Enfin, dernier « inconvénient » à la permaculture si on peut parler ainsi : contrairement à ce qu’on a de plus en plus l’habitude de faire, la permaculture, elle, ne se prête pas vraiment aux copier-coller de techniques.
On l’a déjà répété plusieurs fois ici, mais on insiste vraiment là-dessus, car c’est l’un des principaux travers auquel on est confronté lorsqu’on se lance en permaculture.
Or, copier une technique sans avoir analysé au préalable si elle est véritablement adaptée à notre contexte mène le plus souvent à l’échec !

C’est pourquoi faire son jardin en permaculture implique vraiment de toujours garder à l’esprit que toute stratégie, technique ou outil que vous souhaitez employer doit absolument être adapté à votre contexte unique (contexte humain, climatique, financier, local…).
Créer un jardin en permaculture permet de répondre à nos besoins humains tout en améliorant notre environnement (développement de la biodiversité, création d’habitats pour la faune et les insectes utiles, enrichissement de la terre…).
Un jardin en permaculture a, en effet, vocation à remplir plusieurs fonctions.
En plus de la production alimentaire de fruits et légumes au potager, il peut servir à la production de :
Un jardin en permaculture sert également à la création d’espaces de vie relaxants, romantiques ou ludiques…
Le tout est de savoir par où commencer et de suivre pas à pas la méthodologie de design pour concevoir efficacement en fonction de ses propres objectifs, envies et contextes !
Cependant, nous ne sommes pas tous prêts à nous investir dans un projet global avec la réalisation d’un design complet, faute de temps, de moyens, de priorités…
Alors pour celles et ceux qui voudraient découvrir en douceur la permaculture sans y consacrer trop de temps, nous avons conçu une formation vidéo en ligne intitulée « le Potager 3P ».
Cette formation vous permet d’expérimenter la permaculture dès maintenant sur une petite parcelle de votre terrain (12 m2), sans passer par une longue phase d’étude, en suivant notamment le principe de permaculture « commencez petit ».
Cette formation vous apprendra à créer facilement et rapidement, selon les principes de permaculture, votre Premier Potager Permanent à base de plantes vivaces qui, en plus d’être esthétique et nourricier, sera un excellent support pédagogique d’observation.
Rentrons maintenant dans le vif du sujet : comment procéder pour se lancer concrètement et enfin faire son jardin en permaculture !
Ça ne vous aura pas échappé, si vous êtes arrivé(e) jusqu’à ce stade de votre lecture : ce que nous voulons vous faire comprendre c’est qu’il n’y a pas de jardin en permaculture sans un minimum de design (ou conception) préalable. On ne s’appelle pas Permaculture Design pour rien 😅 !
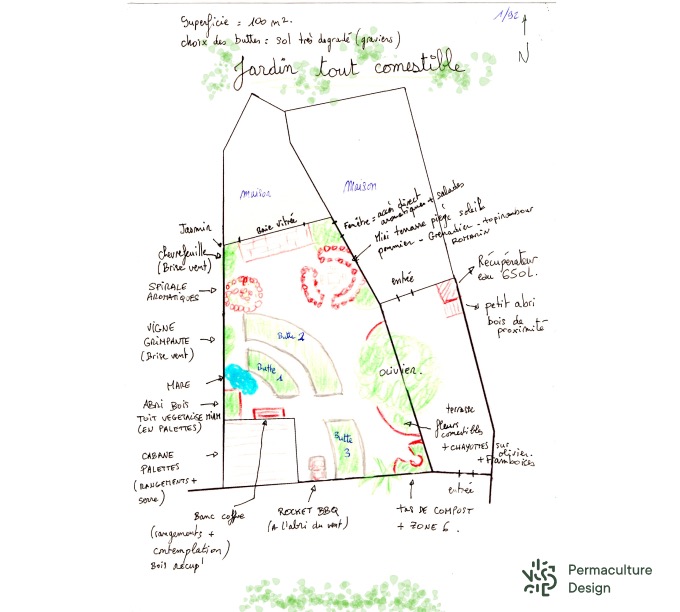
Pour faire votre jardin en permaculture, vous allez donc devoir faire votre propre design !
Rassurez-vous, même si le mot peut faire peur, c’est à la portée de toutes et tous avec un minimum de travail !
Et le jeu en vaut vraiment la chandelle.
Vous avez l’embarras du choix pour apprendre à appliquer cette méthodologie de design à votre projet !
Vous pouvez tout à fait choisir votre propre méthodologie en glanant des informations sur Internet ou dans diverses lectures de livres sur la permaculture, car beaucoup de choses sont aujourd’hui accessibles sur internet.
Si vous choisissez ce chemin, vous devrez notamment faire le tri dans toutes les informations recueillies et cela peut s’avérer très long et fastidieux, mais également très stimulant.
Vous pouvez aussi faire le choix de gagner du temps et de vous faciliter la tâche en vous laissant guider pas à pas à travers les différentes étapes de la méthodologie telle que nous l’avons synthétisée dans notre formation vidéo en ligne dédiée au design de permaculture : « Invitez la permaculture dans votre jardin ».
Pour ne pas vous laisser sur votre faim, voici un résumé des 8 étapes clés pour réaliser votre propre conception en permaculture :
Pour plus de détail sur chacune de ces 8 étapes clés, lisez notre article dédié à la méthodologie de design en permaculture.
La permaculture est donc un concept global qui peut s’appliquer à tous les domaines de la vie : le jardin, la maison, les communautés humaines, l’entreprise, le développement personnel… et bien sûr aussi le potager !

Le but d’un potager en permaculture est de produire des fruits et légumes sains et nutritifs tout en prenant soin de la nature et l’écosystème.
Bien souvent, c’est la partie du jardin qui intéresse le plus les personnes en recherche d’alimentation saine, d’autonomie et de pratiques respectueuses de la nature.
Cependant, c’est principalement au potager que la permaculture est injustement réduite à un ensemble de techniques de jardinage !
Elle est vue comme un agrégat de recettes toutes faites applicables partout, ce qui génère bien des confusions, frustrations et abandons de projet chez ceux qui ont appliqué des techniques dites de permaculture sans les mettre au regard de leur contexte particulier.
Donc, oui, la permaculture s’applique aussi au potager, mais il est important de considérer son potager comme un élément parmi d’autres dans votre jardin, un élément qui devra être pensé en fonction des principes de permaculture et mis en synergie avec les autres éléments de votre jardin.
Avant de vous livrer une liste non exhaustive de techniques phares du potager en permaculture, nous souhaitions donc attirer une fois de plus votre attention sur le fait qu’avant d’appliquer une technique, quelle qu’elle soit, vous devez la passer à travers le filtre de votre contexte propre (géographique, climatique, pédologique, topographique, humain, financier…) et de vos objectifs précis pour voir si elle sera adaptée dans votre cas.
Même si, la permaculture ne doit pas être réduite à des techniques de jardinage, il y a tout de même plusieurs techniques et stratégies de bases relativement passe-partout à connaitre pour pouvoir juger ensuite de leur pertinence et de leur faisabilité dans votre cas particulier puis les expérimenter si besoin.
Une des techniques phares en permaculture qui tranche avec le jardinage traditionnel où on laisse la terre à nu est l’utilisation de paillage aussi appelé mulch pour couvrir le sol.
Cela sert notamment à protéger le sol, à conserver son humidité et dans le cadre d’un paillage organique, à nourrir la vie du sol.
Cette précieuse vie du sol (bactéries, champignons, vers de terre, cloportes, nématodes, collemboles…) contribue à rendre le sol plus fertile d’année en année grâce à la décomposition de la matière organique et sa transformation en humus.

Hormis quelques périodes clés de l’année, comme le début du printemps, où on découvrira le sol pour lui permettre de se réchauffer plus vite ou pour faire certains semis délicats, on va donc s’attacher, sur la majeure partie de l’année, à ne pas laisser le sol nu.
Pour cela, on utilise donc du « mulch » (ou paillage).
Ce mulch peut être vivant (espèces végétales couvre-sol, densité élevée de plantations), minéral (pierre, ardoise…), végétal (paille, foin, bois broyé, miscanthus, etc.), ou issu de déchets compostables intéressants comme le carton brut (sans colle, sans encre)…
Pour en savoir plus sur ce sujet, retrouvez en fin d’article un lien vers notre dossier complet sur les paillages.
Nous vous partageons aussi ci-dessous notre vidéo explicative sur le mulch en permaculture.
Récupérer, faire circuler et utiliser au mieux l’eau est essentiel dans un jardin en permaculture, et ce besoin s’accentue vraiment depuis quelques années où nous connaissons des sécheresses intenses à répétition !
L’eau doit donc être captée et recyclée au maximum sur nos lieux et, à fortiori, dans nos potagers.
Non seulement l’eau garde le sol et les plantes hydratés, mais elle attire également la faune.
Ainsi, des cuves de récupération d’eau de pluie sont des éléments très pertinents à installer au niveau des descentes de gouttières.
La circulation de cette eau récupérée avec la gestion des trop-pleins est une stratégie essentielle pour un potager luxuriant et pour vous éviter au maximum d’avoir à arroser avec l’eau de ville.

De plus, l’eau de pluie, chargée d’éléments nutritifs, est particulièrement bonne pour le jardin potager.
Par exemple, une eau de pluie ayant d’abord servi au bain des canards peut ensuite être infiltrée près des plates-bandes de culture, et sera une aubaine pour la plupart de vos légumes.
Dans un potager en permaculture, le support de culture qui va accueillir vos légumes joue un rôle prépondérant dans la réussite de celui-ci.
Chaque support de culture est une technique en soi et correspond à certains types de jardinage, de contextes, d’objectifs.
Or, en permaculture, contrairement à ce qu’on pourrait croire, il n’est pas obligatoire de « faire des buttes », car cette technique, de plus en plus galvaudée, peut ne pas être adaptée dans votre cas et s’avérer parfaitement contre-productive !
Aussi pour économiser de l’énergie et du temps, notamment si vous débutez en jardinage, choisissez correctement votre support de culture afin qu’il soit réellement adapté à vos objectifs et votre contexte (humain, environnemental, climatique…).
Vous éviterez ainsi bien des écueils et autres échecs dus à des supports de culture inadaptés.
Pour en savoir plus sur ce sujet, retrouvez en fin d’article un lien vers notre dossier complet sur les buttes de culture.
Plusieurs principes de permaculture tels que :
nous le rappellent : pratiquer des associations positives de plantes tombe sous le sens.
Ainsi, en permaculture, légumes, herbes, fleurs comestibles, petits arbres fruitiers et plantations d’ornement sont couramment cultivés ensemble.

Ils interagissent de manière vertueuse et diminuent les efforts que vous aurez à fournir pour un potager productif et en bonne santé : remontée d’eau, de nutriments, création de microclimats, attraction de pollinisateurs, répulsion d’indésirables…
Les avantages des associations de plantes et de légumes en particulier sont très nombreux.
Pour plus de détails, nous vous invitons à lire sur notre blog les articles sur les successions de légumes et les contre-plantations écrits par Joseph Chauffrey, spécialiste des petits potagers urbains en permaculture.
Retrouvez aussi l’article de Jérôme Boisneau, maraicher en permaculture, sur les associations de légumes qu’il utilise dans son activité professionnelle.
Parmi les techniques connues, il y a les jardins en forme de « trou de serrure » ou keyhole garden qui sont des modèles très esthétiques favorisant « l’effet de bordure » et la création de microclimats propices à la biodiversité et aux plantes cultivées dessus.
Cependant, les jardins en « trou de serrure » sont assez énergivores à mettre en place et difficile à déplacer une fois réalisés, c’est pourquoi, là encore, nous vous invitons à bien vérifier s’ils sont pertinents pour votre projet et si oui, où ils devront être placés par rapport à vos autres éléments du jardin…
Ils sont généralement surélevés, ronds, en forme de fer à cheval dans les jardins en permaculture.
Au centre d’un Keyhole Garden, facilement accessible, se trouve souvent un composteur intégré pour aider au maintien de la fertilité de l’ensemble de l’ouvrage.
Mais selon vos envies, ou vos besoins, le centre peut plutôt être occupé par un arbre, un arbuste ou encore une petite mare…
La culture en « lasagne » est une technique très répandue, car très simple et très souvent super efficace, en particulier pour les plantations de légumes annuels gourmands (tomates, aubergines, courgettes, poivrons…).

Passe-partout, elle peut même se pratiquer hors sol, en ville, sur du béton ou autres surfaces urbaines hors-sol, à partir du moment où on a assez de matières organiques à empiler pour former sa butte en lasagne et de l’eau pour amorcer sa décomposition !
Son nom de culture en lasagne vient, bien sûr, du célèbre plat italien, puisque cette technique permacole revient, grosso modo, à empiler des couches successives de matières organiques : des couches de matières vertes plutôt azotées et des couches de matières brunes plutôt carbonées…
Pour savoir comment faire, étape par étape, un tel support de culture, nous vous invitons à lire notre article sur la culture en lasagne.
Il est primordial de prendre soin de son sol en y favorisant la vie et notamment les vers de terre qui sont essentiels dans un jardin en permaculture.
Ils aident à garder le sol meuble et en bonne santé.
Une bonne structure du sol se compose d’une grande population de vers de terre, de micro-organismes, bactéries, champignons, algues et insectes bénéfiques.
Donc, il est important de ne pas utiliser de pesticides et autres fongicides chimiques qui détruiraient la vie de votre sol.
Faire son compost est un autre élément important dans un jardin en permaculture où « Tout déchet » doit être pensé comme « une ressource inexploitée ! ».
Ainsi tous les matériaux pour la fertilisation et le paillage seront produits dans le jardin en permaculture : les déchets du jardin seront utilisés pour le compostage, qui à son tour, sera utilisé pour l’amendement du sol.

Pour en savoir plus sur le compost, retrouvez en fin d’article un lien vers notre dossier complet sur ce sujet.
Vous l’aurez compris, pour bien débuter un projet en permaculture, il est important de garder en tête les éthiques et les principes de permaculture pour vous guider dans vos choix.
De plus, cela vous permettra d’apprendre à définir vos objectifs précis et à connaître vos contextes uniques pour pouvoir ensuite choisir de façon pertinente les techniques, stratégies et outils adaptés dans votre cas.
Pour parvenir à cela en toute sérénité, les géniaux inventeurs du concept de permaculture que sont Bill Mollison et David Holmgren, ont développé une méthodologie pour que chaque personne souhaitant se lancer ait une démarche structurée à suivre pour concevoir son projet en permaculture.
Cette démarche de conception a été éprouvée par divers permaculteurs de renom à travers le monde (Geoff Lawton, Darren J. Doherty, Sepp Holzer, Emilia Hazelip, Andy et Jessie Darlington, Ben Falk, Martin Crawford, Richard Perkins…) et elle s’est enrichie et a évolué au fil du temps.
C’est pourquoi vous trouverez aujourd’hui, comme c’est le cas pour les principes, différentes formulations de cette démarche de conception.

Mais toutes ses formulations gardent en commun les faits :
L’acronyme BOLRADIME résume bien toute la démarche de conception à mettre en œuvre.
Vous verrez aussi parfois l’utilisation de l’acronyme OBREDIM qui déroule un peu différemment la méthodologie.
Au bureau d’études, nous nous appuyons sur la méthode BOLRADIME, car c’est celle qui correspond le mieux aux étapes de conception que nous pratiquons dans nos designs.
Voici ce que cet acronyme signifie :
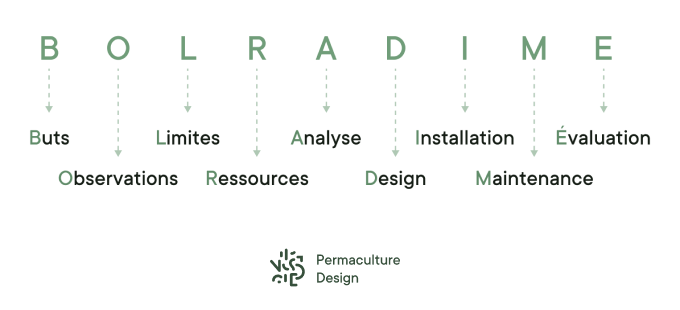
Alors si vous voulez vous lancer dans un projet en permaculture et le réussir sereinement, suivre une démarche de conception sera vraiment inévitable.
Loin de vous faire perdre du temps comme certaines personnes pressées peuvent le croire, cela vous fera gagner des années et économiser beaucoup d’efforts inutiles et d’argent.
La démarche de conception va, en effet, vous aiguiller vers un ensemble de techniques et stratégies vraiment efficaces pour vous, vous évitant ainsi de vous égarer dans des actions énergivores et inutiles voire contre-productives !
Depuis 2011 qui marque le début de l’aventure Permaculture Design, notre bureau d’études a accompagné des centaines de personnes dans leurs projets en permaculture.
Dès 2013, nous nous rendons compte que les demandes d’aides aux accompagnements de projets notamment familiaux avec de petits moyens sont trop nombreuses pour que nous puissions y répondre individuellement avec notre seule équipe du bureau d’études.
Il y a trop de demandes, parfois géographiquement très éloignées de nos bureaux et un suivi de projet de design prend beaucoup de temps, notre planning d’équipe se remplit trop vite et nous sommes affligés de devoir refuser autant de demandes d’aides faute de disponibilités.
C’est pourquoi nous nous lançons dès 2014 dans la création de formations en ligne pour permettre à un maximum de personnes de devenir autonomes dans le lancement de leur projet en permaculture.
Pour débuter sereinement en permaculture, les formations en ligne sont des outils formidables !
Elles permettent de se former facilement de chez soi avec un simple accès Internet et d’apprendre à son rythme avec un accès 24 h/24, 7 j/7 sans limites de temps.

Alors si vous souhaitez vous faire aider dans la réalisation de votre projet pour avoir des bases solides sur lesquelles vous appuyer et ne manquer aucune des étapes fondamentales à la réussite de votre jardin en permaculture, nos formations en ligne sont idéales.
Et parmi nos 10 formations en ligne disponibles à ce jour, voici les 3 principales sur les 3 thématiques essentielles que sont le design, le potager et la forêt-jardin :

C’est LA formation sur la méthodologie de design incontournable qui va vous accompagner, pas à pas, dans toutes les étapes de la démarche BOLRADIME dont nous vous parlions plus haut dans cet article.
C’est la toute première formation en ligne que nous avons réalisée dès 2014, c’est celle qui permet vraiment de faire soi-même sa conception en permaculture quels que soient votre projet, votre contexte et vos objectifs et cela où que vous vous trouviez sur la planète.
👉 Elle a déjà aidé plus de 6000 personnes à se lancer alors pourquoi pas vous ?
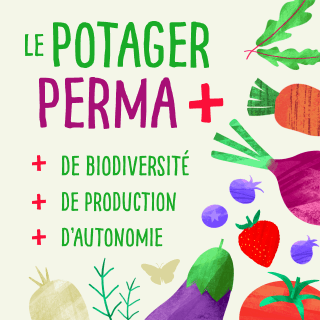
Plus récente, et née, elle aussi, d’une demande croissante de nos abonnés pour des aides à la culture potagère dans le respect de la permaculture, cette formation s’adresse donc aux personnes souhaitant avant tout démarrer une production potagère en permaculture.
Elle a pour vocation de vous mettre le pied à l’étrier pour faire de vous un(e) jardinier(ière) confiant(e) et expérimenté(e), capable ensuite de voler de ses propres ailes.
Cette formation vous accompagne donc pas à pas dans la création et la gestion d’un potager permacole avec l’éventail complet de légumes annuels qu’on aime retrouver au potager. Il vous guide dans la culture des fameux légumes du soleil que sont les tomates, aubergines, poivrons ou encore les courgettes, mais aussi celle des grands « classiques » comme les salades, haricots, carottes, oignons, poireaux, pommes de terre, etc.
Le potager Perma+ n’est pas qu’un simple potager.
C’est un véritable mini-écosystème en permaculture, pensé comme un potager-école, dans lequel nous vous guidons à toutes les étapes depuis la préparation du sol jusqu’aux plantations, semis et récoltes de chacun des légumes préconisés.
Et cette formation va plus loin encore, puisque pendant 3 ans, elle vous explique, mois par mois, tout ce que vous devez faire sur vos plates-bandes de cultures.

Cette formation sur la forêt comestible n’a pas été produite par notre bureau d’études mais bien par un spécialiste de la foret-jardin en Europe, Martin Crawford lui-même.
Nous le remercions d’ailleurs de nous avoir permis de traduire et diffuser sa formation afin de vous faire profiter de toute son expertise.
Cette formation s’adresse tout particulièrement à celles et ceux qui souhaitent installer chez eux un paysage semi-forestier comestible, médicinal et utile, avec peu d’entretien.
Et quand l’un des meilleurs spécialistes mondiaux de la forêt jardin, vous explique très simplement, étape par étape, comment créer et installer la vôtre, tout devient beaucoup plus simple 😉 !

Nos 7 autres formations en ligne sont ensuite des briques complémentaires à ajouter à votre projet selon vos objectifs.
Elles traitent par exemple des poules, des guildes et haies en permaculture, des cultures potagères vivaces ou encore de la pharmacie naturelle avec les plantes médicinales.
Une fois votre jardin en permaculture conçu et réalisé avec tous les éléments que vous aurez choisis d’y inclure pour répondre à vos objectifs, il se régénérera un peu plus chaque année.
Vous verrez revenir avec bonheur la biodiversité et pourrez profiter de récoltes de plus en plus abondantes au fil du temps en échange d’un peu d’attention de votre part.

Nous espérons que cet article aura répondu à vos attentes et que vous comprenez mieux maintenant ce qu’est un jardin en permaculture et comment le réaliser chez vous.
N’hésitez pas à nous partager vos avis en commentaires !
Continuez votre découverte sur comment faire un jardin en permaculture en lisant nos articles et dossiers complets sur divers sujets phares :
À bientôt 👋 !
L’équipe du bureau d’études Permaculture Design
L’article Comment faire un jardin en permaculture ?Les bases indispensables à connaître. est apparu en premier sur Permaculture Design.
Permaculture Design, 22/04/2024 | Source: PermacultureDesign
La permaculture au jardin potager, c’est vraiment pour tout le monde et pour tous les terrains !
Que vous soyez jardinier débutant, poussé par l’envie de prendre en main votre alimentation, de manger des légumes bons et sains.
Ou plus expérimenté, en recherche de solutions pour augmenter vos récoltes, tout en économisant votre temps et votre énergie.
La permaculture apporte des réponses pérennes et efficaces, adaptées à chaque contexte.
Ainsi, grâce à des pratiques douces et régénératrices pour la nature, vous serez capable de produire des récoltes abondantes sur le plus petit espace possible et sans vous épuiser.
Le potager en permaculture s’inscrit aussi dans un système, le design, indispensable à votre réussite.
Des stratégies de culture au design, on vous explique tout dans ce guide complet !
Et si vous souhaitez vous lancer dès maintenant sans prise de tête ni grosses erreurs, découvrez notre méthode « pas à pas », adaptée aux 100 % débutants en cliquant ci-dessous 👇

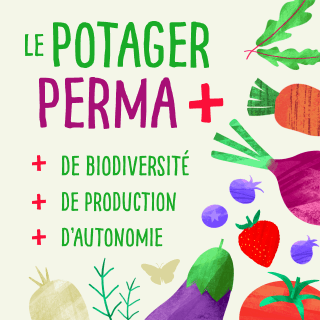
Notre formation en ligne dédiée vous guide de A à Z dans la création et la gestion d’un potager en permaculture : on vous dit précisément quoi faire, tous les 15 jours pendant 3 ans !
Alors si vous êtes pressé.e de vous y mettre sans faire n’importe quoi, découvrez vite notre potager-école, le potager Perma+ !
Alors que le potager peut être énergivore et chronophage, la permaculture regorge de stratégies pour optimiser l’espace, l’énergie, le temps.
Entrons tout de suite dans le vif du sujet !
Collecter l’eau de pluie
L’eau, source de vie, est considérée en permaculture comme un flux énergétique. Elle est tellement précieuse au potager que vous devez y porter une attention toute particulière, et essayer d’optimiser sa collecte au mieux.
Récupération de l’eau de pluie des toitures et stockage en citerne, collecte via une mare dans le potager, etc. toutes les solutions sont bonnes !

Principe de permaculture
Collecter et stocker l’énergie
www.permaculturedesign.fr
L’arrosage automatique
Que vous ayez une toute petite parcelle, ou un potager plus grand, l’arrosage en été peut devenir très chronophage, surtout si les pluies sont peu fréquentes.
Vous aurez sans doute réfléchi à cela au moment de la conception de votre design (dont on vous parle un peu plus loin dans cet article), mais c’est important d’anticiper la question avant la pleine saison potagère.
Un arrosage maîtrisé est un arrosage qui assure un apport régulier et juste par rapport aux besoins des plantes.
C’est la meilleure façon d’en prendre soin, et de leur éviter les chocs thermiques à répétition.
Un arrosage maîtrisé évite les gâchis d’eau et d’énergie humaine. Pour cela plusieurs solutions sont à explorer, par exemple :
Au potager en permaculture, on essaie de limiter le plus possible les fuites d’énergie.
C’est pourquoi le compostage est une pratique essentielle.

Principe de permaculture
Tout déchet est une ressource inexploitée
www.permaculturedesign.fr
En recyclant les déchets de la cuisine ou du jardin, on en fait une matière riche et bénéfique pour le potager.
Un véritable or noir, capable de nourrir et de protéger le sol.
Faire son compost est à la portée de tous.
Il vous suffit de choisir la méthode qui vous convient, tant il y a de façons de faire : compostage de surface, compostage en tas, en composteur de jardin, en lombricomposteur, etc.
Avoir un grand potager, c’est bien, mais avoir un petit potager, cultivé de manière intensive, c’est encore mieux !
Pourquoi ?
Tout simplement, parce que vous dépensez moins d’énergie, d’eau et de temps à entretenir un petit espace.
C’est notamment ce que nous préconisons dans notre formation en ligne « Le potager Perma+ » qui inclut, pour commencer, seulement 3 platebandes de 5 m2 dédiées aux cultures de légumes annuels.
Il vaut donc mieux commencer sur une petite surface, puis quand on maîtrise bien, s’étendre si besoin.

Principe de permaculture
Commencez petit, puis étendez-vous
www.permaculturedesign.fr
Les zones non cultivées pourront être laissées en coins sauvages.
Ainsi, elles ne demandent pas d’entretien et favorisent la biodiversité.
Concrètement, comment faire pour utiliser son potager au maximum de ses capacités ?

Qui a dit qu’il fallait cultiver uniquement à l’horizontal ?
Laissez aller votre créativité et imaginez des systèmes en 3 dimensions en donnant de la hauteur à votre potager.
Des surfaces où faire grimper les plantes, il y en a quantité à exploiter : les murs et clôtures, les abris de jardin, pergolas, etc.
Un mur est une aubaine !
En plus d’emmagasiner la chaleur, il permet à certaines plantes de se développer sans prendre d’espace au sol, moyennant la mise à disposition d’un support.
On peut y faire pousser des petits arbustes comme les mûriers, framboisiers, vignes, kiwis, etc.

Construire des structures au potager
Au sein même du potager, dans et entre les planches de culture, on peut installer différents supports.
Treillis en formes de tipi ou de tente canadienne, grillages, tunnels, portiques accueillent joliment vos haricots à rames, petits pois, courges, concombres, melons, etc.
Vos plantes potagères grimpantes ainsi palissées libèrent la place au sol pour d’autres cultures.
Une technique à utiliser aussi pour le potager urbain !

Densifier les cultures, c’est faire en sorte que toute la surface de vos plates-bandes soit occupée par des plantes.
Voici 2 stratégies pour optimiser l’espace au potager en permaculture :
👉 Par exemple, on peut faire pousser des carottes, des radis ou du basilic au pied des tomates.
Pour densifier vos cultures efficacement, on ne saurait trop vous conseiller de pratiquer les associations des légumes au potager.

Au fil du temps, les jardiniers ont remarqué que certaines combinaisons de plantes cultivées ensemble étaient vertueuses.
On peut citer la fameuse association « les trois sœurs » qui mêle maïs, courge et haricot à rames :
Autre exemple, l’oignon, l’ail, l’échalote ou le poireau protègent les carottes de la mouche Psila rosae, son principal parasite.
En échange, la carotte repousse par son odeur la mouche mineuse, principal ravageur des cultures de poireaux, oignons, échalotes et autres plantes du genre Allium.

Ce qu’il faut retenir, c’est que plus on diversifie les cultures sur une même zone, plus ce milieu devient résilient.

Principe de permaculture
Utiliser et valoriser la diversité
www.permaculturedesign.fr
La polyculture, pratique incontournable du potager bio en permaculture, limite le développement des maladies ou aide à contrôler la présence des indésirables.
Dans un milieu biodiversifié, ces derniers passent moins facilement d’une plante à l’autre.
Ils risquent de tomber plus souvent sur des prédateurs naturels à même de vous en débarrasser, sans que vous ayez à lever le petit doigt !
Bien connaître le développement des plantes
Là, ça devient un peu subtil.
Accélérer la succession des cultures demande de bien connaître le cycle des plantes, leur temps de croissance.
De cette façon, on peut prévoir combien de temps elles vont rester en terre, et quelle emprise elles auront au sol.
À partir de là, il est possible d’établir un planning pour chaque plante prenant en compte toutes les étapes depuis le semis jusqu’à la fin de la culture.
Pour vous aider dans cette planification, nous vous invitons à découvrir le calendrier perpétuel du jardin-forêt et potager productif proposé par Franck Nathié de l’association la Forêt Nourricière.


Découvrez le calendrier perpétuel du jardin-forêt et du potager permacole, un formidable outil pour faciliter votre planification mensuelle.
Il est également possible, avec plus de temps et de recherches, de trouver divers calendriers de cultures en ligne ou dans les ouvrages de jardinage.
Toutes ces informations pourront vous servir de base, de repères au démarrage, mais ce sera à vous d’affiner en fonction de votre climat régional et de votre microclimat à la maison.
Ensuite, au fil du temps, vous optimiserez cette organisation grâce à votre expérience, aux tests que vous pourrez faire, etc.
En parallèle, deux techniques permettent de gagner en productivité.

Démarrer les cultures hors-sol
En démarrant vos cultures hors sol, vous limitez le temps d’occupation des plantes au potager.
Cela laisse ainsi la place à d’autres.
Et puis bien sûr, cela vous permet de commencer une culture alors que les conditions extérieures ne sont pas optimales.
À noter, que mis à part quelques exceptions, quasiment tous les légumes peuvent être démarrés en semis en pots, avant d’être repiqués en pleine terre.
Avez-vous déjà tenté les semis en godets des pois, fèves ou betteraves ?
Promis, ça fonctionne très bien !

Chevaucher les cultures
Le principe du chevauchement des cultures est de faire cohabiter des plantes à des stades différents de développement, plutôt que d’attendre la toute fin d’une culture avant de planter la suivante.
Par exemple, au mois de septembre, on peut installer de jeunes plants d’épinards, de chicorées ou de choux asiatiques, sous une culture en fin de cycle comme la tomate.
Le temps que la tomate termine sa production de fruits, les jeunes plants commencent à développer leur système racinaire.
Puis, quand le pied de tomates en fin de cycle est supprimé (on laisse les racines en place et on paille le sol avec les parties aériennes), les nouvelles cultures ont déjà bien démarré.
Elles profitent à leur tour pleinement de la lumière.
On gagne ainsi un peu de temps sur les nouvelles cultures.

Les légumes vivaces au potager, des alliés précieux.
Le choix des végétaux à cultiver au potager est important, car il conditionne les stratégies ainsi que les efforts à mettre en place pour avoir d’abondantes récoltes.
Privilégier les légumes pérennes peut être très intéressant quand on a peu de temps à consacrer au potager car ils sont rapidement autonomes.
Les légumes vivaces au potager produiront, en effet, plusieurs années en demandant très peu d’entretien de votre part.
Poireau perpétuel, oignon rocambole, asperge, artichaut, topinambour, rhubarbe, chénopode Bon-Henri, chou de Daubenton, haricot d’Espagne…il existe un large panel de légumes potagers vivaces pouvant vous satisfaire !

C’est une stratégie à réfléchir pour voir si elle correspond ou non à vos objectifs, sachant que les légumes vivaces peuvent tout à fait cohabiter avec des légumes annuels 😉.
C’est le cas, par exemple, dans la formation « Le micro jardin-forêt productif » que nous avons réalisé avec Franck Nathié de l’association La forêt nourricière.
Quels légumes annuels cultiver dans votre potager en permaculture ?
À la différence des légumes vivaces qui vivent plusieurs années, les légumes annuels ou bisannuels accomplissent leur cycle complet de végétation en un an (annuel) ou deux ans (bisannuel).
Ils doivent donc être ressemés tous les ans ou tous les deux ans si on veut les récolter au potager.
Mais comment choisir ces légumes à cultiver ?
Pour le choix des légumes annuels, choisissez en priorité :

Pour cela, rien de tel que d’observer ce que cultivent les jardiniers expérimentés autour de chez vous.
Si vous souhaitez malgré tout produire certains légumes peu adaptés à votre contexte, sachez que l’énergie à y consacrer sera beaucoup plus importante pour la même récolte.
Cela vous demandera peut-être la mise en place d’un abri pour des légumes avec d’importants besoins en chaleur ou un arrosage conséquent pour des légumes gourmands en eau.
Encore une fois, tout dépend de votre contexte et de vos objectifs.
Pour vous mettre sur la piste, voici un petit tour de France des semences adaptées à votre région.
Amis des Hauts-de-France, que diriez-vous de (re) découvrir le choux frisé grand vert du nord ?
Vous vivez à l’est, peut-être serez-vous ravis de déguster une carotte de terroir, la carotte jaune obtuse du Doubs ?
La rougette de Montpellier, cette laitue pommée d’hiver devrait faire son effet dans l’assiette des plus sudistes d’entre nous.
Quant aux Bretons, on vous envie le melon petit gris de Rennes !
Où trouver ces légumes vivaces ou annuels ?
Voilà, vous avez fait le tour des catalogues de légumes vivaces et annuels.
Vous avez choisi les variétés les plus adaptées à votre contexte.
Vous salivez déjà à l’idée de déguster les fruits savoureux de votre production.
Oui, mais, où trouver tous ces légumes ?
Et puis, c’est un peu comme l’histoire de l’œuf et de la poule, faut-il partir de la graine ou du plant ?

Si vous êtes vraiment débutant ou que vous manquez de temps ou de place en intérieur pour organiser vos semis, il peut être intéressant de commencer certaines cultures avec des plants.
Cela peut vous faciliter le travail.
Essayez alors, dans la mesure du possible, de vous fournir auprès de pépiniéristes ou maraîchers locaux qui produiront certainement des variétés adaptées à votre région.
Notez quand même qu’en faisant une partie de votre potager à partir de plants à repiquer, le choix des variétés sera beaucoup plus restreint.
Il faudra aussi prévoir un budget plus conséquent que si vous partez de la graine.
En avançant dans votre apprentissage du potager en permaculture, vous serez sûrement de plus en plus tenté de réaliser vos semis vous-même.
En partant de la graine, vous ouvrez en effet la porte sur le monde extraordinaire de la diversité végétale.
C’est sûr, vous n’aurez qu’une envie : découvrir de nouvelles variétés saison après saison.
Les semenciers bio deviendront vos partenaires de jardinage préférés, car ils sont les gardiens d’un trésor inestimable : des variétés de légumes par milliers, parfois anciennes, que vous ne trouverez pas en jardinerie traditionnelle.
Mais surtout, ces graines sont reproductibles, c’est-à-dire qu’elles produisent des fleurs et des fruits dont les graines peuvent être récoltées, conservées, ressemées l’année suivante, et échangées avec d’autres jardiniers.
Vous aurez le plaisir de cultiver l’épinard monstrueux de Viroflay, le poivron chocolat ou la tomate bonne fée.
Ça vous dit ?

En produisant vos graines vous-même, vous accédez à plus d’autonomie, car vous n’avez plus à acheter de semences.
Cerise sur le gâteau : en sélectionnant les graines des plus beaux légumes de votre potager, celles-ci s’adaptent aux conditions de sol et de climat dans lesquelles elles évoluent, et deviennent plus résistantes.
La ferme de Sainte-Marthe et La bonne graine sont de bonnes adresses pour vous procurer des graines.
Si vous préférez échanger avec d’autres particuliers, rendez-vous sur des sites comme Graines de troc ou dans les bourses aux graines locales ;).
Installer une citerne à eau, préparer les zones de culture, brasser son tas de compost, broyer les branchages, pailler, semer, planter, arroser, récolter…
Le jardin potager requiert votre attention à différents moments de l’année.
Grâce à un design, il sera le plus économe possible, mais certaines actions ne pourront se faire sans vous.
Faire le plan de son potager en permaculture
Faire le bon geste au bon moment est une question d’observation, mais aussi de planification.
Voilà pourquoi, vous ne pouvez pas vous passer d’un temps de réflexion pour organiser votre année au potager.
Pour garantir la réussite de vos cultures, vous devez élaborer votre outil de pilotage complet.
Son rôle est de vous guider tout au long de l’année en vous donnant les repères dont vous avez besoin.
Il peut contenir les informations suivantes :
Profitez de l’hiver pour prendre le temps de penser à tout cela, bien au chaud autour d’une tasse de thé.
Une feuille et un crayon, et votre potager prend vie !
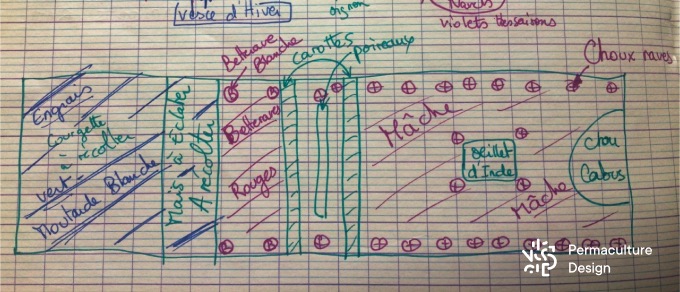
Si toutes ces stratégies sont efficaces, elles le sont d’autant plus dans un écosystème équilibré.
C’est pourquoi le permaculteur cherche à prendre soin du sol et de la biodiversité.
Ce qu’on adore avec la permaculture, c’est qu’elle offre des solutions à tout !
Et notamment, elle donne des clés pour faire pousser des végétaux dans n’importe quelles conditions.
Un sol vivant étant un sol suffisamment humide, aéré et riche en matière organique, votre mission numéro 1 consiste à en prendre soin.
Aérer le sol de votre potager
Plusieurs stratégies s’offrent à vous.
Surtout, n’hésitez pas à les cumuler !
La première consiste à prévenir le tassement du sol :
Une autre approche consiste à utiliser les « services biologiques » que peuvent nous rendre la vie du sol et certains végétaux.

Principe de permaculture
Utiliser et valoriser les services et les ressources renouvelables & biologiques
www.permaculturedesign.fr
En stimulant cette vie du sol grâce, notamment, à l’apport de matière organique — déchets de cuisine, compost, fumier, etc. — les vers de terre travaillent pour vous !
Ils digèrent la matière organique et forment des galeries pour se déplacer.
Résultat : ils ameublissent le sol et l’aèrent !
Certains engrais verts sont aussi de précieux alliés : en s’enfonçant dans la terre, leurs racines décompactent le sol laissant ainsi pénétrer l’oxygène.
La moutarde ou encore des céréales comme le seigle et le petit épeautre sont de bonnes candidates pour jouer ce rôle.
Enfin, vous pouvez choisir d’aérer mécaniquement le sol en passant la grelinette ou la fourche-bêche, mais sans retourner la terre pour ne pas perturber ce milieu vivant !
Assurer la fertilité du sol
Pour assurer la fertilité du sol, la règle de base, c’est de le nourrir en apportant de la matière organique qui va se transformer en humus.
Pour cela, vous pouvez exploiter les ressources déjà disponibles sur votre terrain ou dans votre voisinage, et les étaler directement sur vos planches de culture :

Certaines plantes comme la consoude ou l’ortie sont de véritables plantes ressources au jardin en permaculture.
Qu’elles soient ajoutées au compost, transformées en purins (extraits fermentés) ou tout simplement « coupées & déposées » au sol, elles sont idéales pour entretenir la fertilité du sol.
Encore une fois, les engrais verts et notamment les plantes de la famille des légumineuses aident à améliorer la fertilité du sol.
Lentilles, lupins, fèves, pois captent l’azote de l’air (un des nutriments nécessaires à la croissance des végétaux), et le redistribuent au sol.
Veillez néanmoins à les couper avant la floraison, sous peine de perdre l’effet nutritif recherché.
Sinon, les plantes auront utilisé en partie cet azote pour produire leurs fleurs, puis leurs graines.
Si vous avez des poules, c’est magnifique !
Laissez-les travailler pour vous en leur confiant une partie de votre potager avant sa mise en culture.
En grattant le terrain et en y déposant leurs déjections, le sol est amendé naturellement, sans effort de votre part.
Pas mal, non ?

Conserver l’humidité
Lorsqu’un sol est riche en matière organique et protégé par un mulch ou paillage, il garde un bon taux d’humidité.
La matière organique se gorge d’eau comme une éponge, et constitue ainsi une réserve.
Puis, grâce au travail d’aération des vers de terre notamment, l’eau s’infiltre doucement dans le sol pour profiter aux plantes.
De même, le paillage permanent isole du soleil et du vent, et évite ainsi l’évaporation.
Et la boucle est bouclée !
C’est ce système vertueux que vous devez entretenir au quotidien pour obtenir un sol équilibré, une bonne terre de jardin pour la culture de vos légumes au potager.
On n’a pas tous la chance de démarrer avec un sol en bonne santé.
Aussi, notre objectif est de créer les conditions pour tendre vers cet idéal, en donnant vie à notre potager en permaculture pas à pas.
C’est là où la permaculture est vraiment puissante : elle offre tout un panel de solutions pour différents contextes.
La culture en lasagne
La culture en lasagne est intéressante, car elle permet de démarrer rapidement un jardin potager en permaculture sur quasiment tous les terrains, et sans travail du sol.
Il s’agit d’alterner différentes couches de matières, comme pour la célèbre recette de pâtes, d’où son nom.
Pour plus de détails, rendez-vous sur notre article dédié à la culture en lasagne.
Cette technique est parfaite pour débuter son potager en permaculture.
On peut aussi la réaliser en bac pour un potager sur le balcon.
Les buttes de culture

Les buttes de permaculture répondent à des problématiques spécifiques.
Si elles sont très populaires, on souhaite vous rappeler que les buttes ne sont pas un passage obligé pour conduire un potager en permaculture.
Et surtout, le choix du type de butte doit être minutieusement réfléchi, et pertinent dans votre contexte.
Si par exemple votre terrain est très humide, les buttes pourront apporter des solutions appropriées en surélevant vos cultures et en drainant l’eau.
De nombreux permaculteurs ont cherché la meilleure façon de concevoir des buttes.
Vous trouverez donc différentes méthodes, parmi :
À l’inverse, en climat très sec, vous aurez tout intérêt à cultiver dans des plates-bandes décaissées qui favorisent la rétention de l’eau.

Être attentif à la Terre
Être attentif à la Terre est l’une des 3 éthiques de la permaculture.
Cela implique que nos activités ne nuisent pas à la Terre, mais au contraire qu’elles la régénèrent et la protègent.
L’objectif est de faire de votre potager en permaculture un écosystème équilibré.
On ne va donc pas séparer le monde cultivé du monde sauvage, mais l’intégrer et même l’inviter.

Principe de permaculture
Intégrer plutôt que séparer
www.permaculturedesign.fr
D’abord, parce que la nature a une valeur intrinsèque, mais aussi pour les services écologiques qu’elle assure, à commencer par la pollinisation par les insectes, essentielle à la fructification de nombreux légumes.
Pourquoi laisser des zones sauvages proches du potager ?
Des zones sauvages à proximité de votre potager sont de vrais refuges pour la faune des jardins.
Des herbes hautes, de vieilles souches de bois morts ou un tas de branches laissé ici ou là offrent ainsi le gîte et le couvert à de nombreux animaux.
Certains jouent le rôle d’auxiliaire en protégeant votre potager.
Vous pouvez aussi leur donner un coup de pouce en fabriquant des hôtels à insectes, des nichoirs, des abris pour les oiseaux, les hérissons ou les chauves-souris.
Retrouvez ici 👉 tous nos articles sur la biodiversité et comment la favoriser dans votre jardin en permaculture pour plus de résilience.
Des plantes mellifères dans le potager en permaculture
En cultivant des plantes mellifères (par exemple, les plantes aromatiques comme la menthe, la sauge, le thym, le romarin, etc.), les insectes pollinisateurs comme les abeilles, bourdons, syrphes, papillons, viennent aussi visiter le potager et améliorent ainsi vos récoltes en pollinisant les fleurs de vos légumes et fruits préférés.

Les effets de bordure en permaculture : définition
En observant la nature, vous constaterez que les bordures ou lisières entre deux milieux différents sont des lieux riches et variés qui accueillent de nombreuses espèces d’animaux comme de végétaux.
La magie se produit effectivement quand deux milieux se rencontrent : une haie et une pelouse, une mare et une prairie, etc.
La zone de bordure servant d’interface entre les deux milieux différents tire généralement des avantages des deux milieux et devient un espace foisonnant de vie !
C’est aussi dans la diversité des formes que s’exprime cet effet de lisière.
Ainsi des formes complexes favorisent davantage la biodiversité que des formes simples.
Voilà pourquoi en permaculture on crée souvent des zones de culture avec des motifs : courbes, spirales, en trous de serrure, en mandalas, etc.
La mare au potager en permaculture
La mare est un élément incontournable pour favoriser la biodiversité au potager.
Même un petit bassin a un impact important.
Bien sûr, il attire les grenouilles friandes d’insectes ou encore les crapauds qui raffolent des limaces et vous en débarrasseront au potager pour le plus grands plaisir de vos jeunes salades !
Il offre aussi aux oiseaux, insectes et autres petits mammifères un point d’eau où venir s’abreuver.

Vous pensez à présent avoir les clés pour pratiquer la permaculture au jardin potager ?
Vous y êtes presque !
Un dernier élément important doit entrer dans l’équation : le design de permaculture, cet outil formidable qui a le pouvoir de transformer votre expérience du jardin potager grâce à une gestion efficace de vos ressources.

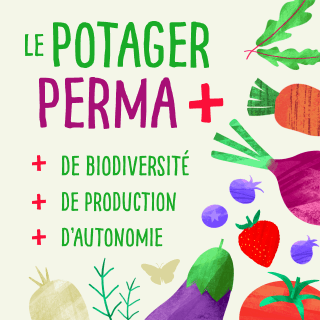
Notre formation en ligne dédiée vous guide de A à Z dans la création et la gestion d’un potager en permaculture : on vous dit précisément quoi faire, tous les 15 jours pendant 3 ans !
Alors si vous êtes pressé.e de vous y mettre sans faire n’importe quoi, découvrez vite notre potager-école, le potager Perma+ !
Concevoir un design : le cœur de la démarche de permaculture
Le design, c’est un outil de conception et de planification de projets permettant l’organisation d’activités humaines, et l’aménagement de lieux durables en accord avec les éthiques et les principes de la permaculture.
Cela est défini ainsi par son co-fondateur Bill Mollison, dans son ouvrage « Introduction à la permaculture » :
« Le but est de développer des modes de vie et de fonctionnement qui ne nuisent pas à l’environnement et qui soient viables économiquement, qui subviennent à leurs propres besoins, qui n’abusent ni des humains ni du vivant, qui ne polluent pas la terre, et qui, par conséquent, sont durables sur le long terme ».
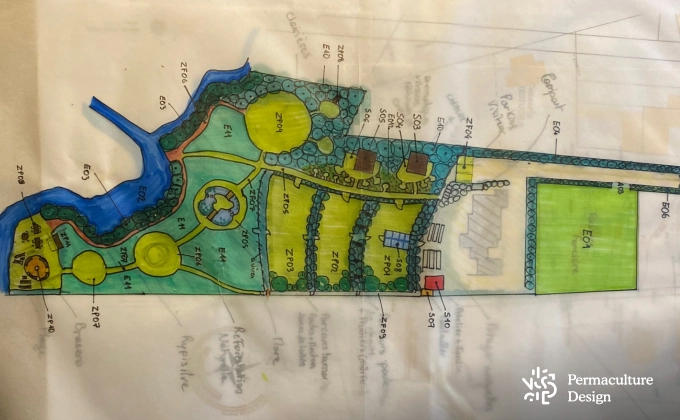
Faire un potager en permaculture, c’est donc établir un système qui est :
Prendre son temps pour en gagner
Vous êtes-vous déjà senti(e) dépassé(e), épuisé(e) par les travaux du potager ?
Nous aussi, on a connu ça, faute de réflexion, tellement impatients de mettre les mains dans la terre !
Pour éviter de reproduire un schéma énergivore, il est nécessaire de procéder autrement, vous en conviendrez.
C’est donc le moment de prendre le temps de vous poser les bonnes questions.
La méthodologie de design vous invite ainsi à définir vos objectifs personnels :
Ça, c’est la base du design.
Mais pour obtenir un système adapté à votre contexte, d’autres éléments sont à prendre en compte, et passent par l’observation et la collecte de données sur votre lieu.
Découvrir le fonctionnement de votre lieu
Un principe phare de la permaculture est inspiré par l’un des pionniers de l’agriculture naturelle, Masanobu Fukuoka.
Il est retranscrit notamment dans son livre La révolution d’un seul brin de paille, et invite à « travailler avec la nature plutôt que contre elle ».

Principe de permaculture
Travailler avec la nature et non contre elle
www.permaculturedesign.fr
Et pour cela, il convient d’abord de l’observer.
Identifier les éléments naturels, leurs dynamiques, leurs potentiels, les éventuelles contraintes, bref, il s’agit de comprendre le fonctionnement de votre site.
Voici quelques éléments sur lesquels porter votre attention.
Le soleil
Vous pouvez commencer par observer l’orientation de votre potager et repérer les zones exposées au soleil, ainsi que celles qui sont à l’ombre.
Ces informations, collectées sur plusieurs saisons, vous seront utiles pour placer au mieux vos zones de cultures, et pour choisir les végétaux adaptés aux différentes situations de votre potager.

Le vent
Repérez les zones venteuses et le sens du vent en observant la végétation : dans quelle direction penche-t-elle ?
Observez aussi en passant du temps sur votre lieu pour mieux comprendre la façon dont le vent circule.
Grâce à cette information, vous pourrez, si c’est nécessaire, prévoir la mise en place d’un brise-vent pour protéger vos cultures potagères.
L’eau
L’eau, c’est la vie, on en a déjà parlé plus haut dans cet article !
Vous en aurez donc besoin pour arroser vos cultures.
L’idée ici est d’observer où l’eau rentre sur votre terrain, comment elle circule et par où elle ressort de chez vous, si toutefois elle n’a pas été totalement collectée sur votre terrain.

Principe de permaculture
Conserver l’énergie
(Recycler, faire circuler et optimiser)
www.permaculturedesign.fr
C’est pourquoi il est important de repérer ces sources d’eau et entrées d’eau disponibles sur votre terrain : cours d’eau, mare, puits, toitures pour la récupération d’eau de pluie, etc.
Connaître la pluviométrie sur votre région est un autre détail important qui vous permettra notamment de calculer les volumes d’eau de pluie récupérables chez vous et vous donnera une indication sur les besoins en eau à apporter à votre potager.
Ces données, notées sur un plan, vous aideront à optimiser le trajet de l’eau sur votre lieu pour en stocker suffisamment pour vos légumes (baissières, cuves, mares…).
Le sol
Observez à présent votre sol.
Est-il compacté ou meuble ?
Est-il vivant ?
Voyez-vous des vers de terre, beaucoup ou non ?
Est-ce qu’il colle ou au contraire est-ce que la matière file entre vos doigts ?
Est-il gorgé d’eau en hiver ?
Bien comprendre la nature de votre sol vous permettra de choisir le bon support de culture, d’effectuer les bons gestes et d’amener des matières organiques adaptées pour le rendre plus fertile.

Les plantes spontanées, des herbes pas si mauvaises !
Avez-vous identifié les plantes sauvages qui poussent sur votre sol ?
Y a-t-il une diversité des espèces, ou est-ce qu’une seule espèce a colonisé tout l’espace ?
En permaculture, on ne les considère pas comme de « mauvaises herbes », mais plutôt comme des indices nous donnant beaucoup d’informations sur notre sol, sa vitalité, sa fertilité…
C’est pourquoi certaines de ces plantes sont appelées bio-indicatrices, car elles fournissent des informations sur le sol.
Par exemple, un terrain couvert de liseron indique un sol lourd, compacté avec notamment un excès d’azote.
Les plantes ressources
Vous avez des haies ou des arbres sur votre terrain ?
Savez-vous quelles en sont les essences ?
Renseignez-vous sur ces végétaux pour connaître leur fonction : médicinale, comestible, fourrage pour les animaux, mellifère, refuge pour les oiseaux, coupe-vent, brise-vue, esthétique, fixateur d’azote, etc.
Prenons l’exemple du sureau noir (Sambucus nigra).
C’est un arbuste multifonctions très intéressant :
La faune sauvage
Profitez-en pour jouer au naturaliste en herbe et explorer la biodiversité animale : quels insectes, oiseaux et petits mammifères pouvez-vous observer ?
Plus il y a de diversité, plus résilient est votre site, signe d’un écosystème équilibré.
Observer les petites bêtes au potager est un émerveillement quotidien.

Les questions qui se présentent maintenant sont celles-ci.
Après avoir fait l’état des lieux de votre terrain :
Après une analyse guidée par les 3 principes de permaculture présentés ci-dessous, le travail consiste à réaliser un ou plusieurs dessins.
Objectif : trouver la meilleure combinaison possible entre tous les éléments du potager.
Chaque élément doit remplir plusieurs fonctions

Principe de permaculture
Un élément remplit plusieurs fonctions
www.permaculturedesign.fr
Voici un exemple : si vous souhaitez installer une haie brise-vent, celle-ci pourra être conçue de manière à remplir d’autres fonctions.
Selon les espèces de végétaux choisis, elle peut aussi :
Pour citer deux plantes candidates multifonctions et souvent présentes dans les jardins :

Chaque fonction doit être remplie par plusieurs éléments

Principe de permaculture
Une fonction est remplie par plusieurs éléments
www.permaculturedesign.fr
En voici une illustration. Vous aurez besoin de collecter les eaux de pluie et de les stocker pour pouvoir arroser votre potager.
Une première solution consiste à installer des citernes pour récupérer l’eau des toitures.
Une autre option peut être de concevoir une mare.
Planifier l’efficacité énergétique

Principe de permaculture
Planifier l’efficacité énergétique
www.permaculturedesign.fr
Cela revient à réfléchir à la façon dont on va placer les éléments du design en fonction de leur fréquence d’usage ou d’entretien.
C’est ce que l’on appelle le zoning.
Les plantes aromatiques — ciboulette, persil, coriandre, etc. — seront par exemple placées tout près de la cuisine pour en faciliter la récolte et l’utilisation dans la préparation des repas.
La serre devra être placée à proximité d’un point d’eau, mais aussi dans un endroit de passage, car les semis demandent un suivi minutieux.
À l’issue de tout ce travail de collecte de données, d’analyse et de dessin, votre design proposera un système unique, adapté à votre lieu et à vos besoins.
Pour autant, ce n’est pas un système figé.
Celui-ci continuera d’évoluer pour être amélioré, optimisé au fil du temps.


La tonte différenciée utilise les principes de permaculture, comme « favoriser la biodiversité ». Pour un projet de jardin en permaculture résilient et durable, faire son design est une étape incontournable à sa réussite.
Apprenez à faire cette conception de façon efficace et à votre rythme grâce à notre formation en ligne dédiée qui vous guidera pas à pas et s’adaptera à vos objectifs et votre contexte unique !

Et si vous souhaitez commencer en étant guider de A à Z pour ne pas vous prendre la tête, faites confiance à notre formation en ligne « Le potager Perma+ » !

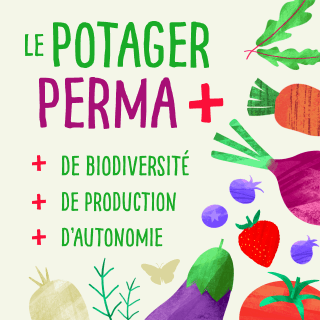
Notre formation en ligne dédiée vous guide de A à Z dans la création et la gestion d’un potager en permaculture : on vous dit précisément quoi faire, tous les 15 jours pendant 3 ans !
Alors si vous êtes pressé.e de vous y mettre sans faire n’importe quoi, découvrez vite notre potager-école, le potager Perma+ !
Retrouvez ci-dessous, une sélection de livres qui nous semble pertinente pour approfondir ce sujet du potager en permaculture 😉.
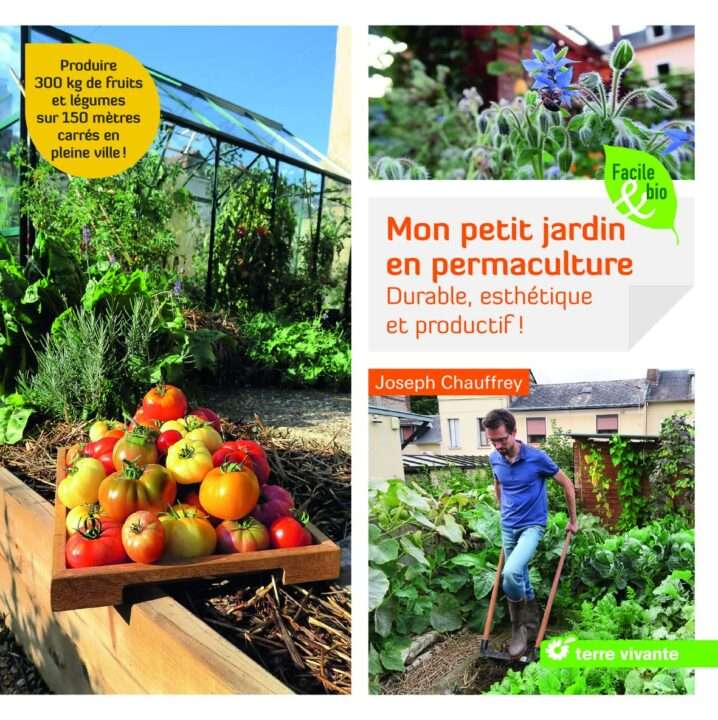
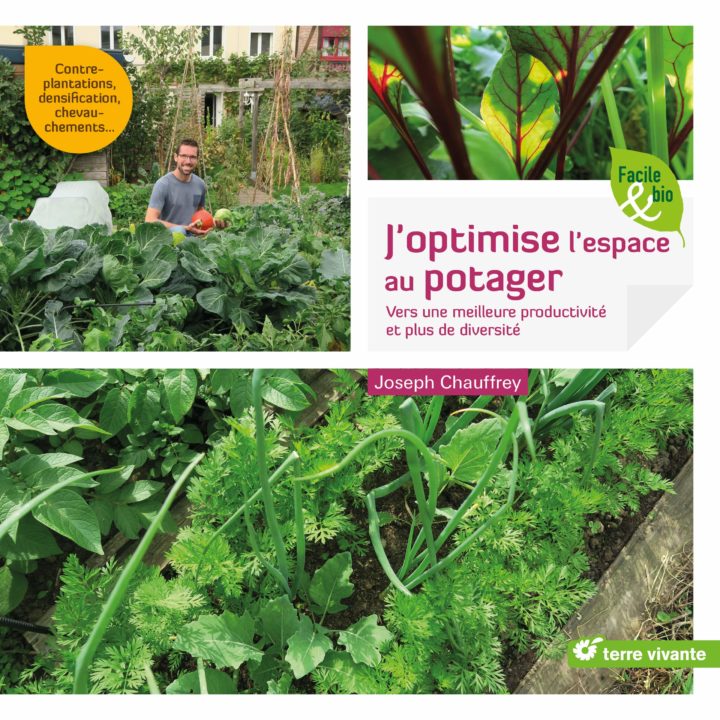
Joseph Chauffrey
Édition du Terre Vivante
Environ 14 €
Amazon | Decitre | FNAC | Unithèque | Librairie Permaculturelle
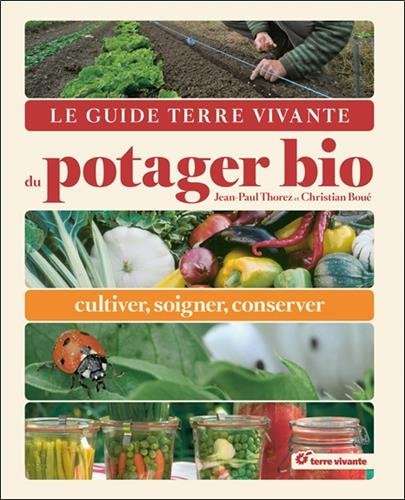
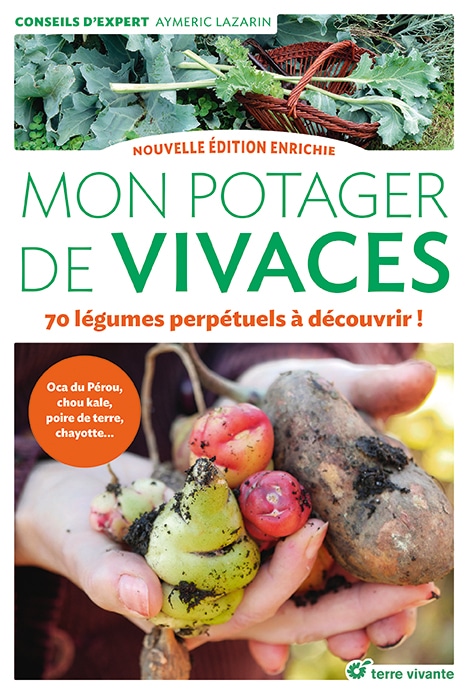
Aymeric Lazarin
Édition du Terre Vivante
Environ 26 €
Amazon | Decitre | FNAC | Unithèque | Librairie Permaculturelle
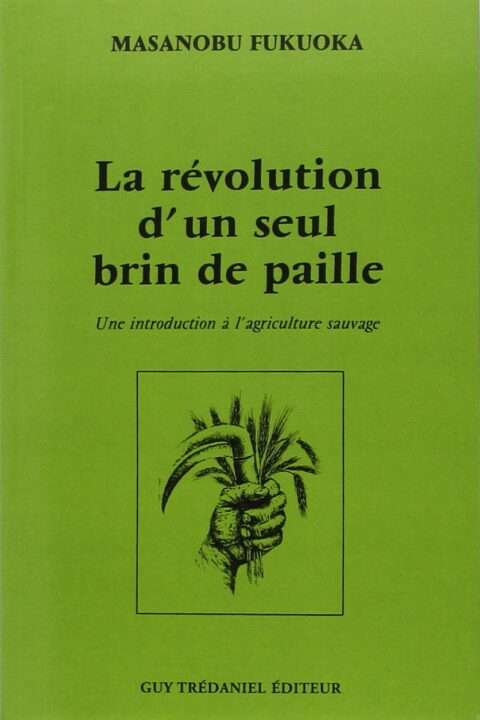
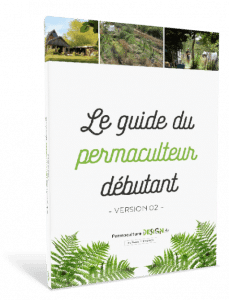
Ne ratez plus aucun de nos contenus et recevez « Le guide du permaculteur débutant »
L’article La permaculture au jardin potager : le guide complet est apparu en premier sur Permaculture Design.
Permaculture Design, 11/04/2024 | Source: PermacultureDesign
Découvrez le verger naturel insolite mis en place par Mathias André en Normandie, au cœur de son lieu de vie : la ferme en multi-activités « Aux Coul’Eure du Cheval » où la présence des animaux est très importante.
Mathias est notre expert et formateur en verger naturel.
Il nous fait visiter cet îlot de biodiversité avec un verger naturel sur 4 hectares qui a été conçu pour accueillir également des activités d’élevages d’animaux, pension de chevaux, du maraichage, de l’hébergement insolite, de la formation et bien plus encore…
Ce verger naturel, avec ses 3 ans d’existence, est déjà rentable et va encore beaucoup se densifier pour multiplier les sources de revenus à l’avenir.
Dans ce témoignage vidéo, Mathias revient sur les choix faits, la diversification des activités, les différentes stratégies mises en œuvre sur le terrain et tout ce qui fait du verger naturel un modèle d’avenir pour la culture fruitière.
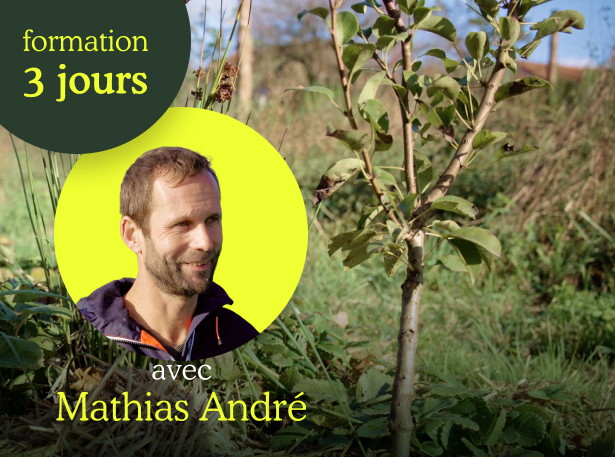
Cette formation de 3 jours s’adresse autant aux particuliers qu’aux professionnels.
Sur la ferme « Aux Coul’Eure du Cheval » où vivent et travaillent Mathias André et sa compagne Sylvie Dévigne, différentes activités se développent et beaucoup d’animaux se côtoient au quotidien.
La ferme propose des services de travaux agricoles en traction animale (débardage, ouverture de milieux naturels, entretien de rivière…)
Il y a aussi une partie pension pour des chevaux, un service de location de calèches pour des événements spéciaux ou du transport scolaire, des accueils de scolaires et de centre de loisirs, mai aussi un élevage d’ânes normands (espèce en voie de disparition), des moutons, des poules, des canards, des cochons et même un bouc.

En plus de ces activités autour des animaux, Mathias et Sylvie ont décidé de se diversifier en installant, il y a 3 ans, un verger naturel sur 4 hectares.
Situé sur l’ancienne parcelle de production de foin, l’agencement du verger naturel permet de continuer cette production essentielle aux animaux.
Mais, en plus, ce verger naturel a donc été conçu par Mathias dans le but de devenir lui aussi un support pour de nouvelles activités et donc de nouvelles sources de revenus sur la ferme.
Il inclura notamment à terme :

Le verger naturel a été implanté sur une terre dégradée, maltraitée par l’agriculture conventionnelle avec des désherbages chimiques et des engrais de synthèse.
C’était donc, au début de l’installation, une terre sans vie microbienne, un lieu sans biodiversité ni animale ni végétale.
Et tout autour de la parcelle de verger naturel, c’est un vrai désert avec une alternance de cultures agricoles en conventionnel de blé et de colza, pas un arbre et donc pas de mésanges, très peu d’insectes pollinisateurs, etc.
Cependant, Mathias note avec bonheur que depuis l’installation du verger naturel sur cette parcelle, il y a 3 ans, il double la quantité de vie microbienne dans le sol chaque année, ce qui est très réconfortant !
ll peut en effet mesurer cela avec des tests sur la conductivité du sol.

Le verger naturel a, bien sûr, pour objectif la production de fruits… mais pas uniquement !
Il se veut aussi une vitrine de ce que l’on peut faire avec la méthodologie du verger naturel tel que Mathias l’enseigne notamment dans notre formation « Créer et installer un verger naturel en permaculture ».
Les principes de fonctionnement et la méthode de création d’un verger naturel sont toujours les mêmes, mais d’un porteur de projet à l’autre, le résultat sera à chaque fois différent.
Ce verger naturel est donc un support pour les formations sur site et le conseil des porteurs de projets.
Pour cela, il inclut :



Parmi les agencements possibles, Mathias nous montre un agencement linaire particulièrement adapté aux petites surfaces.
Si vous avez, par exemple, un petit jardin de 200 m2 et un gros objectif de production, il faudra partir plutôt sur du linaire avec du tuteurage avec fils pour pouvoir densifier.
Dans cet exemple, Mathias a choisi d’installer des framboisiers avec, au-dessus, une vigne en raisin de table et de l’autre côté, tous les 3 ou 4 m des arbres fruitiers, ici des figuiers, des pommiers.
D’expérience, Mathias estime le chiffre d’affaires de telles lignes à 6 000 € pour 100 mètres agencés de cette façon-là.

Dans son verger naturel, tel qu’il l’a conçu aujourd’hui, hors production de châtaignes, car celle-ci ne sera optimale que dans une dizaine d’années, le chiffre d’affaires potentiel est d’environ 40 000 € à l’hectare.
C’est le chiffre d’affaires moyen par hectare pour un verger naturel.
Sur sa parcelle de quatre hectares, il peut produire autour des 120 000 € de fruits de façon naturelle respectueuse du vivant.
Vu le contexte actuel, avec la flambée des prix de l’énergie et des denrées alimentaires, mais aussi la perte constante de biodiversité, le verger naturel est clairement un système d’avenir.
C’est une méthode structurée avec des itinéraires techniques simples et qui est facile à mettre en œuvre.
Et pour Mathias, elle a, en plus, trois principaux avantages :
Dans cet exemple d’un verger naturel sur 4 ha, l’investissement total de départ a été de 3000 €.
Il a été réparti dans l’achat de :

Si au départ, à l’installation, le verger naturel a nécessité des intrants venus de l’extérieur (paillages et engrais organiques…), il a quand même été conçu pour devenir de plus en plus autonome au fil des années.
C’est donc un système qui, à maturité, produira sa propre fertilité (BRF) et pourra se passer de tout intrant extérieur.
En plantant un verger naturel, même sur un site dégradé et un sol quasi mort comme cela a été le cas pour Mathias ici, on agrade tellement l’environnement que très rapidement le sol s’améliore, la vie revient…
Grâce aux plantations diverses, dans le respect du sol et du vivant, les oiseaux, insectes pollinisateurs et autres auxiliaires reviennent un peu plus chaque année.
Le retour de la biodiversité est un vrai plus pour la résilience de l’ensemble du verger naturel et un vrai bonheur à observer au quotidien.

Tous les projets de vergers naturels sont différents.
Dans celui de la ferme de Sylvie et Mathias, où les animaux sont omniprésents, les projets d’avenir sont les suivants :

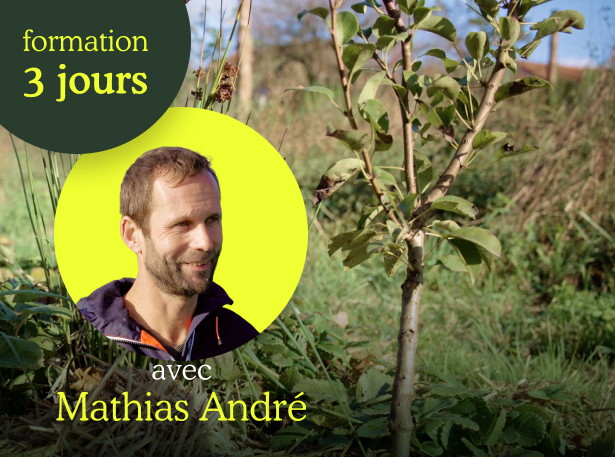
Cette formation de 3 jours s’adresse autant aux particuliers qu’aux professionnels.
Quand on sait tailler et greffer les arbres fruitiers, comme dit Mathias, tout est possible !
Même si on fait des erreurs, on peut les corriger en changeant de variétés par exemple.
Se former aux savoirs de la greffe et de la taille/conduite des arbres fruitiers est donc primordial pour pouvoir ensuite avoir une grande liberté d’action et pouvoir planter dès que possible, sans hésiter, car les erreurs faites seront faciles à corriger au besoin !

L’article Un verger naturel dans une ferme en Normandie est apparu en premier sur Permaculture Design.
Permaculture Design, 09/04/2024 | Source: PermacultureDesign
Les mares naturelles et les zones humides en général se raréfient de plus en plus sur nos territoires.
Leurs comblements et destructions au profit de zones industrielles, commerciales ou autres vont, hélas, bon train.
C’est toute la biodiversité liée à ces milieux aquatiques naturels qui en pâtit de plus en plus.
C’est pourquoi il nous semble urgent de réagir, car oui, nous pouvons, toutes et tous, avoir un impact positif là-dessus, chacun à notre niveau, en commençant par œuvrer à la protection des batraciens !
Découvrez 11 conseils pratiques de notre ami Gilles Leblais, ornithologue, naturaliste et photographe de la vie sauvage pour agir dès maintenant et protéger les batraciens dans nos jardins !
En termes de protection des batraciens, le plus efficace, est d’abord de leur offrir un lieu de vie accueillant sur votre terrain en créant une mare naturelle.

Cette formation de 3 jours s’adresse autant aux particuliers qu’aux professionnels.
Même dans un tout petit jardin de quelques mètres carrés, vous pouvez installer une petite mare naturelle (plus ou moins 1 m2, c’est déjà très bien !).
Elle sera un refuge précieux pour les batraciens à partir du moment où elle est conçue correctement, à l’image de la nature (voir ci-dessous d’autres conseils pour bien l’aménager) !
Alors, dès que vous le pouvez, quelle que soit la taille de la mare que vous pouvez créer, petite ou grande, elle contribuera forcément à la survie d’une ou plusieurs espèces de batraciens !

Cet aménagement n’a l’air de rien, mais il est d’une importance capitale !
Il se fait après la mise en eau et doit comporter le plus d’abris possible pour maximiser les chances de voir ces batraciens auxiliaires élire domicile dans notre jardin.
Pour ces abords de la mare naturelle, Gilles Leblais conseille d’inclure notamment du bois mort (vieux troncs, vieilles souches) et des pierres.
La façon de positionner ces éléments a aussi son importance.
Au niveau des pierres de bordure de mare, on retiendra sur trois astuces pour maximiser l’accueil des batraciens :

Une mare naturelle « se nettoie » périodiquement.
Cette opération, qui se pratique en automne, consiste principalement à retirer les « déchets » végétaux (feuilles mortes, parties de plantes mortes) se retrouvant en excès dans l’eau ou à la surface.
C’est aussi l’occasion de limiter l’expansion de certains végétaux aquatiques vigoureux prenant beaucoup de surface, en en retirant une partie.
L’ensemble des matières organiques retirées de la mare naturelle (végétaux morts ou vivants) peuvent ensuite servir de mulch au jardin ou être placées au compost, selon vos besoins.
La fréquence de ces nettoyages est directement liée à la taille de votre mare.
Plus sa surface sera petite, plus les nettoyages seront fréquents.
Mais Gilles nous alerte ici sur le fait de ne pas tomber dans l’excès au niveau de ces nettoyages.
Il est important de toujours garder une partie des sédiments tombés au fond de l’eau.
Ils servent notamment aux tritons et grenouilles pour se cacher de prédateurs ou pour hiverner.

Pour protéger certaines espèces de batraciens pouvant hiberner dans l’eau de la mare, il est important d’avoir une profondeur suffisante pour qu’au moins une partie reste « hors gel ».
Pour cela, Gilles recommande d’atteindre une profondeur d’au moins 80 cm, voire 1 m si possible.
Cette profondeur n’est pas nécessaire sur l’ensemble de la surface, il suffit qu’elle soit atteinte au moins sur une partie de la mare naturelle.
Il est important d’installer différentes plantes dans l’eau, mais aussi autour de la mare naturelle pour démultiplier les niches accessibles à la biodiversité.

Principe de permaculture
Utiliser et valoriser la diversité
www.permaculturedesign.fr
On implantera donc à la fois des plantes de berges (strate hélophyte) et des plantes aquatiques à diverses profondeurs (strate hydrophyte).
On pense notamment aux nénuphars qu’on place généralement plutôt au fond de la mare, mais sachez qu’il existe, aujourd’hui, des cultivars pouvant être installés à toutes les profondeurs de 20 cm à 1 m.
Ces plantes aquatiques et semi-aquatiques de la mare naturelle sont vitales pour certaines espèces de batraciens.

Les tritons, par exemple, utilisent les plantes aquatiques pour y déposer leurs œufs, un par un, mais toujours sous l’eau, sur une partie constamment immergée de la plante.
Sans elles, pas de reproduction de triton dans votre mare.
Toutes ces plantes permettent aussi aux batraciens de se cacher pour éviter les attaques de certains prédateurs comme la couleuvre à collier ou la chouette hulotte.
Le bois mort est très important pour la biodiversité en générale, mais aussi comme site d’hivernage pour les tritons, les grenouilles…
Il en faut, on l’a vu plus haut, pour aménager le pourtour de la mare naturelle, mais il est aussi très utile plus loin dans le jardin.
Il sera encore plus apprécié des batraciens, si c’est un bois qui retient bien l’humidité comme le bouleau par exemple.

Et même si vous n’avez pas encore de mare naturelle chez vous (on espère que vous en ferez une bientôt 😉), mais qu’il y en a dans les environs, mettre des tas de bois morts dans votre jardin vous permettra d’œuvrer quand même à la protection des batraciens !
Ils pourront ainsi trouver refuge chez vous pour l’hiver, même si leur mare n’est pas sur votre terrain…
C’est un geste simplissime à faire, accessible à tous et très important pour la biodiversité, alors allez-y franchement !
Plus il y aura de bois mort au jardin, plus vous protégerez les batraciens !
Si vous avez ou projetez de faire un petit abri de jardin, des toilettes sèches ou n’importe quel autre type de petite dépendance dans votre jardin, pensez à rehausser votre construction, avec des parpaings par exemple.
Et cela afin de créer un espace accessible aux batraciens entre le sol et le plancher de votre construction.

C’est le genre d’endroit très apprécié des crapauds, comme le crapaud commun par exemple. Celui-ci est aussi un précieux auxiliaire du potager et du jardin en général, car c’est un gros mangeur de limaces et escargots !
Construisez de petits murets en pierres sèches, orientés, de préférence, pour avoir une bonne surface exposée nord.
Vous ferez en sorte qu’ils regorgent de cavités et d’espaces abrités, pour offrir à la fois le gîte et le couvert aux batraciens, notamment au niveau des parties situées au nord qui seront les plus fraîches du muret.

Là encore, ce sera un refuge idéal pour les crapauds, car ils y trouveront cloportes, mille-pattes, limaces et autres petits escargots à déguster.
Ils pourront aussi s’y protéger du soleil et même s’y réfugier pour passer l’hiver.
Vous créerez des niches supplémentaires en installant de vieilles amphores, vieilles cruches ou vases en terre cuite, autour de la mare naturelle de manière à en rendre l’entrée accessible aux batraciens.
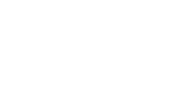

Créez une niche et quelqu’un viendra l’habiter !
— Bill Mollison
Vous apporterez également une touche « déco » sympa à votre mare naturelle tout en recyclant de vieux objets dont vous n’auriez pas eu l’utilité par ailleurs.
Ces abris improvisés seront d’autant plus appréciés que vous laisserez la végétation voisine « les habiller » à la mode nature.
Ils pourront ainsi accueillir toutes sortes de faunes sauvages, y compris des batraciens en quête de refuge !

Si vous avez des pierres plates, plutôt que de les mettre en contact direct avec le sol en bord de mare, pensez à les rehausser, avec des cailloux par exemple, de manière à créer des espaces en dessous, où les batraciens pourront venir se loger !
Ce sera très utile pour les batraciens, comme la grenouille agile et le crapaud, qui vivent principalement sur terre, mais toujours proches d’un point d’eau dont ils ont besoin pour se reproduire…

Enfin, Gilles nous montre une façon ultra simple de créer un abri à batraciens, qui pourra sauver la vie à une ou plusieurs espèces dans votre jardin.
Cet abri pourra être placé aux abords de la mare, mais aussi plus loin dans votre jardin, partout où cela vous semble envisageable en fait !
Pour créer cet abri simple et efficace, un pot de fleurs en terre cuite et quelques pierres suffisent…
On fait une petite ouverture de quelques centimètres dans le bord supérieur du pot, pour qu’une fois le pot retourné, cela fasse une petite entrée accessible aux batraciens.
Puis on place le pot retourné à même le sol et on met une pierre dessus afin de boucher le trou du pot et conserver plus de fraîcheur et d’humidité.
On peut ensuite placer quelques autres pierres autour du pot pour l’inclure un peu mieux visuellement dans le jardin.
Enfin, on laisse la végétation se développer autour pour lui faire un écrin de verdure et le tour est joué ;) !

N’hésitez pas à démultiplier ce type de petits abris, même si vous n’avez pas encore de mare dans votre jardin, car ils contribueront grandement à la protection des batraciens à l’échelle de votre jardin !
🙏 Merci pour eux !
Pour tout savoir sur les mares naturelles, rendez-vous sur notre page dédiée qui rassemble tous nos contenus disponibles et formations existantes sur ce thème majeur en permaculture pour la sauvegarde des milieux humides et de la biodiversité.

Venez apprendre à créer et installer avec l’équipe du bureau d’études Permaculture Design.
Retrouvez également ci-dessous, la présentation des livres de Gilles Leblais, qui peuvent vous inspirer dans la création de votre jardin.
Ils pourront aussi vous permettre d’en savoir plus sur la biodiversité que vous pouvez accueillir, en ayant les bons réflexes dans vos installations et plantations diverses (mares, naturelles, bois mort, haies, trognes…).
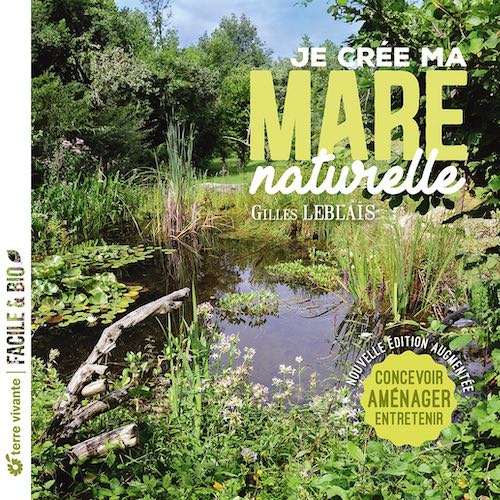
Gilles Leblais
Édition Terre Vivante
Environ 15 €
Découvrez notre article sur le livre de Gilles Leblais « J’aménage ma mare naturelle »
Découvrez notre article sur le livre de Gilles Leblais « La vie secrète de ma mare »
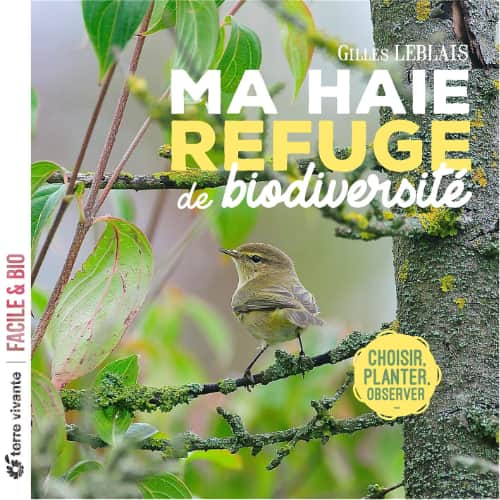
Livre de Gilles Leblais
Éditions Terre Vivante
Environ 14 €
Découvrez notre article sur le livre de Gilles Leblais « Ma haie, refuge de biodiversité »
Découvrez notre article sur le livre de Gilles Leblais « Branchages et bois morts au jardin »
L’article 11 conseils pour protéger les batraciens ! est apparu en premier sur Permaculture Design.
Permaculture Design, 29/02/2024 | Source: PermacultureDesign
Créer une mare naturelle présente un intérêt énorme pour l’attraction et l’accueil de la biodiversité dans son jardin !
Grenouilles, tritons, libellules, oiseaux des jardins, la liste des insectes et animaux dont la survie dépend plus ou moins directement des mares naturelles est énorme.
Or, ces insectes et animaux sont, en très grande majorité, de formidables auxiliaires qui contribueront de façon significative à la stabilité et la résilience de votre jardin en permaculture !
Découvrez, avec notre ami Gilles Leblais, ornithologue, naturaliste et photographe de la vie sauvage, l’incroyable biodiversité que pourra vous apporter une mare naturelle dans votre jardin !
Ci-dessous la vidéo👇.

Cette formation de 3 jours s’adresse autant aux particuliers qu’aux professionnels.
Qu’elle soit petite ou grande, une mare naturelle est plus riche en biodiversité qu’une prairie fleurie, car elle comporte une diversité de milieux plus grande, depuis le fond de l’eau jusqu’aux bordures de la mare.
L’apport d’éléments minéraux (pierres, cailloux, vieilles céramiques, pots en terre cuite…) et organiques (vieilles souches, bois mort) en bordure de mare est d’une importance capitale pour créer des habitats pour la biodiversité.
Avec le temps, ces bordures se couvrent de divers végétaux sauvages et de mousses pour créer des niches très favorables à l’installation durable d’animaux et insectes.

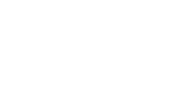

Créez une niche et quelqu’un viendra l’habiter !
— Bill Mollison
Au niveau de la flore, au départ de la création d’une mare naturelle, Gilles conseille d’installer de 4 à 6 plantes aquatiques, à adapter bien sûr selon les dimensions de la mare.
Ces plantes doivent être réparties dans les différentes strates disponibles, des plantes de berges, comme le Caltha des marais, aux plantes de fond des eaux comme les nénuphars en passant par divers niveaux d’immersions des racines dans l’eau.
Ces plantes installées vont s’acclimater peu à peu dans la mare naturelle.
Certaines pourront même, au fil du temps, se répandre, changer d’endroit ou même remonter à la surface, créant ici ou là, des ilots de surface formant de nouveaux milieux encore différents et très intéressants pour la biodiversité !
Puis, dans une mare naturelle bien conçue qui « se peaufine d’ancienneté » comme aime à le dire Gilles, de nombreuses plantes sauvages vont aussi apparaître spontanément sans que vous n’ayez rien à faire d’autre que d’observer 😉.
Gilles donne l’exemple, sur sa grande mare, de l’arrivée de Lysimaque à fleurs en thyrse, de joncs ou encore de prêle des marais !
La végétation dans et autour d’une mare naturelle est donc en perpétuel changement à l’image de la nature.






Or, ce qui est formidable, c’est que la diversification de la flore d’une mare naturelle au fil du temps va de pair avec la diversification de la faune sauvage qui en bénéficie !
Généralement, la faune sauvage est présente quasiment dès la mise en eau d’une mare naturelle. On peut, en effet, voir arriver, par exemple les premiers dytiques (coléoptères aquatiques) ou les premières libellules, à peine quelques semaines après la création de la mare.
Mais cette biodiversité va vraiment croître, elle aussi, au fil du temps, avec de plus en plus d’espèces sauvages qui vont être attirées par ce point d’eau et qui vont pouvoir profiter de sa végétation.

Pour les oiseaux sauvages, la mare naturelle, reflet du ciel, sera un lieu incontournable pour se baigner, chasser ou se désaltérer.
Ils ont donc vite fait de la repérer et de la visiter régulièrement.
Pour les animaux nocturnes volants, elle sera aussi une aubaine.
Les chauves-souris y trouveront le lieu idéal pour se nourrir en chassant moustiques et autres insectes voletant au-dessus de sa surface.
La chouette hulotte pourra venir y chasser quelques grenouilles à rajouter à son régime alimentaire éclectique.

Grâce aux plantes aquatiques en place, de nombreux batraciens trouveront, dans une mare naturelle, le site de ponte idéal.
Les végétaux leur procureront également de l’ombre pour s’abriter ou des cachettes pour éviter les prédateurs.
De plus, avec les changements climatiques actuels et les canicules de plus en plus fréquentes, la mare naturelle devient un véritable refuge essentiel à la survie de plus en plus d’insectes et d’animaux sauvages.
C’est pourquoi en installer dans son jardin dès que possible sera capital pour quiconque souhaite contribuer à son échelle à la sauvegarde de la biodiversité.

Venez apprendre à créer et installer avec l’équipe du bureau d’études Permaculture Design.
Grâce à sa mare naturelle créée il y a plus de 14 ans, Gilles Leblais a pu constater, au fil des années, l’augmentation significative des espèces d’animaux et insectes présentes dans et autour de celle-ci.
Pour les libellules par exemple, il est passé de 2 espèces au début de la création de sa mare à 9 espèces différentes aujourd’hui.
En effet, avec les cycles de la vie qui s’enchainent saison après saison, les plantes font tomber dans l’eau des matières organiques qui constituent peu à peu un substrat au fond de la mare.
Or, dans ce substrat créé au fil du temps, les pontes de libellules vont pouvoir mieux éclore et se développer ! D’où l’augmentation du nombre d’espèces de libellules observées !



Même constat pour les punaises aquatiques chez Gilles.
Si les gerris ou « patineurs d’eau » sont présents depuis les premières années, Gilles observe aujourd’hui d’autres espèces de punaises d’eau très intéressantes comme la notonecte glauque et les naucores.
L’évolution et la diversification des espèces de grenouilles illustrent aussi très bien cette augmentation de la biodiversité au fil des années.
Aujourd’hui, ces deux espèces, bien que moins nombreuses, sont encore là et continuent de venir se reproduire dans cette mare naturelle.



Chez Gilles, ce sont les grenouilles rousses qui sont arrivées en premier suivies par les grenouilles agiles.
Mais il y a aussi maintenant des grenouilles de Lessona et des grenouilles rieuses qui n’étaient pas présentes au début.
Ainsi, plus la mare naturelle prendra de l’ancienneté, plus elle deviendra riche de biodiversité tant au niveau de la flore que de la faune !
Pour s’émerveiller du spectacle de la nature et s’y reconnecter tout simplement, les mares naturelles sont donc sans pareil !
La vie sauvage qu’on peut y observer, quasiment en toute saison, nous offre des moments inoubliables à partager avec nos proches et notamment avec les enfants !
Pour le passionné qu’est Gilles Leblais, les mares naturelles ont même quelque chose de magique, tant elles sont surprenantes et en constante évolution.

C’est pourquoi, il nous invite toutes et tous à en intégrer dans nos jardins en permaculture et jusqu’au pas de nos portes afin de réenchanter nos regards tout en protégeant la vie sauvage.
Alors, n’attendez plus et lancez-vous dans l’aménagement de votre mare naturelle !
Si besoin, nous pouvons vous y aider avec notre formation sur site de 3 jours « Créer et installer une mare naturelle » et vous pourrez, vous aussi, bientôt assister de vos propres yeux à l’épanouissement de la biodiversité chez vous !
Pour tout savoir des mares naturelles, rendez-vous sur notre page dédiée qui rassemble tous nos contenus disponibles et formations existantes sur ce thème majeur en permaculture pour la sauvegarde des milieux humides et de la biodiversité.
Retrouvez également ci-dessous la présentation de deux livres de Gilles Leblais qui peuvent vous aider à peaufiner votre projet pour créer de mares naturelles et en savoir plus sur la biodiversité qu’elles attireront chez vous.
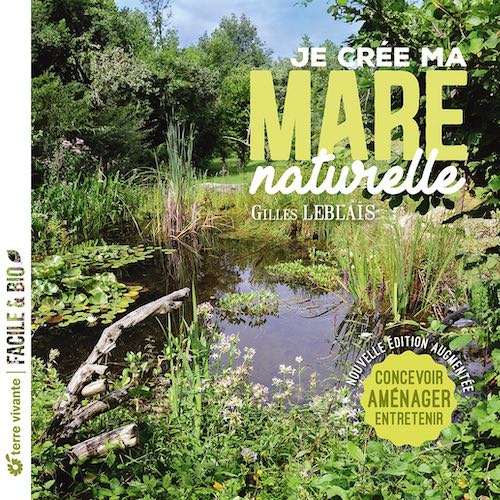
Gilles Leblais
Édition Terre Vivante
Environ 15 €
Vous pouvez aussi lire les articles que nous avons consacrés aux livres de Gilles Leblais :
À bientôt, 👋
L’équipe de Permaculture Design
L’article L’incroyable biodiversité d’une mare naturelle est apparu en premier sur Permaculture Design.
Permaculture Design, 22/02/2024 | Source: PermacultureDesign
Bienvenue dans notre série d’exemples concrets montrant des vergers naturels en permaculture conçus ou suivis par notre arboriculteur expert Mathias André.
Découvrez ici le projet professionnel de Christophe et François Maupin qui se sont reconvertis, à partir de 2018, en arboriculteurs et maraîchers, respectueux de la nature et de sa biodiversité.
Ci-dessous la vidéo pour découvrir ce projet en détail 👇.

Basé à côté de Rouen en Normandie, le projet englobe :
Le tout se situe sur un plateau, en bordure de falaise non loin de la Seine.
Le sol, à tendance calcaire, était assez pauvre à la base, composé principalement de sables fins et de silex.
Historiquement, le terrain choisi semble propice aux cultures de fruits puisqu’il accueillait déjà un verger, il y a une centaine d’années.
Au début des années 2000, Christophe travaille en entreprise avec notamment pour mission de réfléchir et accompagner la transformation du monde agricole pour un avenir plus durable.
Il prend alors conscience de l’ampleur et de la complexité de la tâche et acquiert la conviction que le monde agricole n’abordera pas de lui-même le virage nécessaire dans ses pratiques.

Il change d’activité pendant un temps puis commence à envisager d’autres voies pour son avenir professionnel.
La naissance de deux petits enfants et la lecture de Laudato si’ du Pape François (encyclique consacrée aux questions environnementales et sociales) vont finir de le convaincre d’agir à son échelle !
Il décide donc de se reconvertir dans ce qu’il appelle « un projet agricole du futur », respectueux de la nature, qui fera sens pour sa famille et lui.
C’est tout naturellement qu’il décide de le développer avec son fils François avec qui il partage la passion du jardin.
Leur reconversion professionnelle commence donc en 2018 avec l’achat du terrain, date à laquelle ils rencontrent un arboriculteur passionné, expert du verger naturel, Mathias André.
Ils décident alors de confier à Mathias la vérification de leur conception initiale du verger.
L’impact de Mathias sera décisif pour la suite de leur projet…
Mathias André va, en effet, complètement remodeler la conception initialement pensée par Christophe et François pour rendre l’ensemble du projet beaucoup plus durable, efficace et résilient.
Mathias a, en effet, une grande expérience en termes d’aménagements de verger naturels et d’accompagnements de ce type de projets en plus d’une connaissance fine des végétaux fruitiers et de leur entretien.

Il va donc leur proposer des changements cruciaux pour la réussite de leur projet avec notamment :
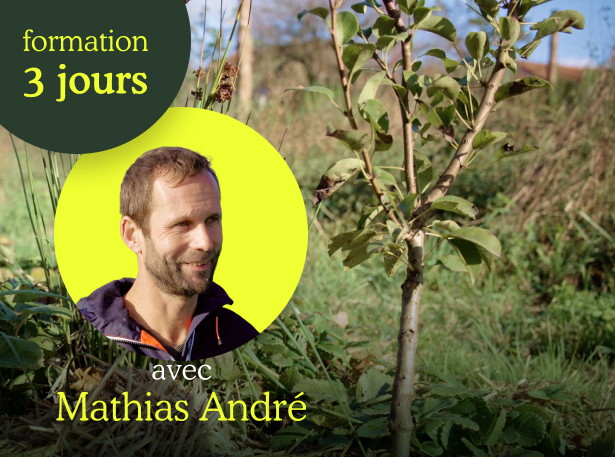
Cette formation de 3 jours s’adresse autant aux particuliers qu’aux professionnels.
Mathias va également les accompagner et les former pour :
👉 Vous avez un projet de verger naturel ou jardin-forêt en France ?
Après avoir bien revu le projet sur le papier en suivant les conseils de Mathias André, Christophe et François commence l’installation concrète avec les premières plantations d’arbres fruitiers à l’hiver 2019, puis de nouveau à l’hiver 2020.
Au total, 2500 arbres sont plantés sur ce verger naturel dont 1/3 d’arbres dits « de services » (dédiés à la production de biomasse pour la fertilité, l’attraction d’auxiliaires…) et 2/3 d’arbres fruitiers.

Sur l’ensemble des arbres fruitiers plantés, le choix est fait d’installer 50 % de pommiers tout simplement pour privilégier la production du fruit le plus consommé par les Français !
Pour s’engager vraiment dans une production de grande qualité, respectueuse de l’environnement, Christophe et François feront aussi le choix d’une certification en agriculture biologique particulièrement exigeante par le biais du label bio Déméter.
L’idée à travers ce projet est de générer à terme 4 emplois pour 4 associés sur les 4 ha de cultures en fruits et légumes.
L’objectif économique du projet est de générer pour chaque associé un revenu mensuel de 2000 €.
Cet objectif est majeur pour Christophe et François, car la rentabilité économique est, pour eux, la condition siné qua none pour faire perdurer le projet dans le temps et donc atteindre tous les autres objectifs visés.
C’est pourquoi le projet a aussi été réfléchi pour minimiser les charges fixes :
Le potentiel de chiffre d’affaires à terme pour ce projet (hors aléas climatiques) est estimé autour des 300 000 € !

Le choix de ne pas inclure de bâtiment de stockage avec chambre froide implique que chaque récolte soit vendue dans la foulée ou transformée rapidement.
Cela n’est possible qu’avec de bonnes compétences commerciales pour vendre rapidement la production, ce que Christophe était en mesure d’assurer.
De même, la transformation rapide après récolte est une possibilité de valorisation qui a été réfléchie en amont du projet pour pouvoir être mise en place efficacement le moment venu avec des acteurs locaux.
Enfin, le choix de ne pas avoir de grosses machines implique une majorité d’actions manuelles, notamment pour les récoltes.
C’est pourquoi Mathias a conseillé des essences fruitières et variétés spécifiques au verger naturel (échelonnements des récoltes…) dans l’optique de permettre à Christophe et François d’assurer d’abord à 2 puis, à terme, à 4 l’ensemble de ce travail manuel !

L’une des plus grandes forces de ce type de projet, qui a paru évidente pour Christophe et François, c’est la diversité :
Cette diversité offre une résilience très importante au projet notamment d’un point de vue économique avec une diversité de sources de revenus.
En effet, il y aura toujours une production qui va réussir et permettre de compenser l’impact d’un éventuel échec sur une autre production !
Enfin, ce projet est aussi en mesure d’évoluer au fil du temps pour offrir d’autres productions, avec par exemple, entre les rangs du verger naturel, des cultures de céréales.

C’est également un système flexible qui laisse la porte ouverte à des possibilités d’élevages d’animaux et donc à des productions d’œufs ou de viande…


Vous souhaitez que l’on vous accompagne
pour créer votre verger nature?

Vous pouvez également suivre une de nos formations en présentiel pour apprendre à concevoir et installer vous-même votre verger naturel.
Pour retrouver Christophe et François Maupin du Jardin verger Saint François, cliquez-ici.
L’article Verger naturel & maraîchage est apparu en premier sur Permaculture Design.
Permaculture Design, 18/01/2024 | Source: PermacultureDesign

Verger classique VS Verger naturel
Le verger naturel en permaculture reste très méconnu, et toujours confondu avec l’image vieillotte des vergers en monoculture.
En effet, dès que l’on parle de verger, on s’imagine des rangées identiques de pommiers à perte de vue, qui seront traités avec des produits chimiques, des dizaines de fois par an.
Une vraie catastrophe pour la nature, les consommateurs et pour l’arboriculteur.🫣😱
Mais heureusement, il existe une alternative écologique et très productive
👉 c’est le verger naturel en permaculture.
Depuis plusieurs années, avec notre spécialiste Mathias André, on milite pour faire connaître le verger naturel, que ce soit :
Le verger naturel s’adresse autant aux particuliers qu’aux professionnels, nous voulons dans cet article vous donner tous les avantages et inconvénients afin que vous puissiez choisir entre verger naturel et classique en toute objectivité.
Alors prêt pour le match verger classique vs verger naturel ?
Si on devait résumer en une phrase le verger classique, on dirait :
De la simplicité à la complexité et non résilience

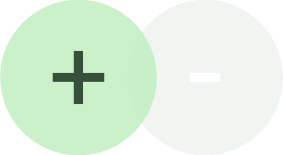
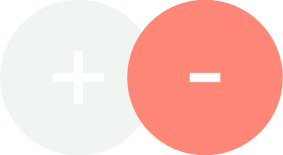
Le verger classique est
Si on devait résumer en une phrase le verger classique, on dirait :
De la complexité vers la simplicité et la résilience.

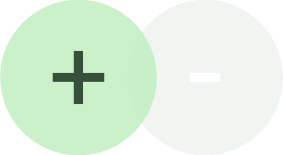
Les bénéfices directs par rapport à un verger classique
Les bénéfices indirects
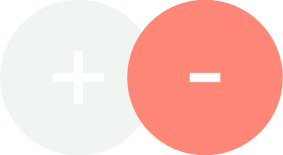
Votre verger naturel doit s’inspirer du fonctionnement de la nature pour :
Un des arguments les plus intéressants en faveur pour le verger naturel en plus de son impact positif sur l’environnement est son coût d’installation et de maintenance.
Il est extrêmement bas. Notre expert, Mathias André, a estimé de par son expérience que le coût d’installation est divisé par 10.
En verger naturel, vous pouvez ainsi installer pour un coût de 2 000 à 6 000 € l’hectare, alors qu’en verger classique nous sommes autour de 20 000 à 60 000 € l’hectare.
Idéal pour lancer une activité économique en étant serein sans s’endetter pendant des décennies. 😎
De plus, si vous suivez la méthode que nous enseignons lors de nos stages sur site, toutes les opérations sont optimisées, vous faisant ainsi économiser temps et argent, et gagner en confort de vie.
Les tailles de formation des arbres, d’entretien, les récoltes, les tontes, les soins préventifs et curatifs à base de plantes, tout est pensé de manière globale, efficace et résiliente.
Bref, avec une bonne conception de votre verger naturel dès le départ, puis une bonne méthode pour sa gestion, même en étant débutant, le verger naturel reste très rentable par rapport à l’investissement de base.
Pour nous, le verger est la solution du futur sans aucun doute tant les avantages économiques et écologiques sont nombreux.
Nous militons avec Mathias André depuis plusieurs années pour faire reconnaître cette technique à sa juste valeur.
Nos conceptions et installations de vergers naturels, ainsi que la transmission de notre méthode à nos stagiaires, nous permettent de vérifier chaque jour la pertinence de ce modèle, que ce soit pour les particuliers ou pour les professionnels.
Alors envie de créer un verger naturel chez vous ? 😉


3 jours de stage avec l’expert des vergers naturels, Mathias Andre, pour apprendre à concevoir, mettre en place et entretenir votre futur verger.
Vous avez encore des questions sur le verger naturel ?
👉Découvrez notre page dédiée au verger naturel
L’article Verger naturel, quelles différences avec un verger classique ? est apparu en premier sur Permaculture Design.
Permaculture Design, 14/12/2023 | Source: PermacultureDesign
Qu’est-ce qu’une marmite norvégienne et comment ça fonctionne ?
Le concept de base de la « marmite norvégienne » est très simple : conserver au mieux la chaleur des aliments préalablement chauffés en les plaçant dans un contenant isolant pour qu’ils continuent de cuire doucement.
Cet objet lowtech de cuisson douce permet de faire de sacrées économies d’énergie et peut être fabriqué par n’importe qui, même avec peu de moyens.
Le nom de « marmite norvégienne » n’étant pas très parlant quant à son usage, celui de « Cuiseur Inertiel Passif » semble plus édifiant.
À l’heure où les prix de l’énergie, gaz comme électricité, flambent et où cuisiner sainement reste une préoccupation majeure, il est urgent de (re)découvrir tous les bienfaits de la « marmite norvégienne ».
Ci-dessous, notre article pour tout savoir sur ce formidable objet Lowtech que sont les marmites norvégiennes ! Bonne lecture.
En fait, la marmite norvégienne n’a pas un inventeur unique, mais plutôt une multitude d’inventeurs pleins de bon sens.
Le procédé de cuisson douce existe, en effet, depuis la nuit des temps.
La marmite norvégienne est donc née des évolutions historiques dans les pratiques de cuisson ayant émergées de manière indépendante dans différentes parties du monde.
Le nom « marmite norvégienne » n’indique donc pas le pays d’origine de cette invention, mais le nom du brevet déposé par un producteur de l’objet à la fin du XIXe siècle.
Ce cuiseur inertiel passif a été particulièrement utile au cours de l’histoire pour économiser de l’énergie et cuisiner de manière efficace, notamment dans les régions où l’accès à du combustible était limité.

L’idée principale est de conserver au maximum la chaleur autour d’un plat préalablement chauffé afin de permettre aux aliments qu’il contient de continuer à cuire doucement sans source de chaleur extérieure.
Pour ce faire, on va entourer le plat en question (c’est-à-dire le contenant de cuisine dans lequel se trouvent vos aliments) d’une matière isolante performante pour « emprisonner » la chaleur à l’intérieur.

Le mode d’emploi d’une marmite norvégienne peut se résumer en 5 étapes simples :
1 — La préparation du plat :
Dans un premier temps, vous cuisinez comme vous en avez l’habitude.
Vous préparez vos aliments et les assemblez dans le contenant qui vous sert habituellement en cuisine.
Seule condition requise pour le choix du contenant dans lequel vous allez cuisiner : avoir un couvercle bien ajusté permettant de le fermer correctement.
Il peut s’agir d’une cocotte en fonte, d’une casserole en inox, d’un plat en terre cuite ou en verre…
2 — Chauffer jusqu’à ébullition :
Puis quand tous vos ingrédients sont bien assemblés dans votre plat, vous le portez à ébullition sur votre plaque de cuisson habituelle.
3 — L’isolation thermique dans le Cuiseur Inertiel Passif :
Une fois que les aliments ont atteint le point d’ébullition, vous coupez la source de chaleur initiale et vous fermez votre plat (cocotte, marmite, casserole…) avec son couvercle.
Puis vous le placez dans le Cuiseur Inertiel Passif (ou marmite norvégienne) qui est tout simplement un contenant isolant, généralement rempli de matériaux isolants tels que de la paille, de la laine, de la mousse de polystyrène, ou des coussins thermiques.
Ce faisant, vous minimisez les pertes de chaleur.
4 — Patienter le temps de la cuisson douce :
À l’intérieur du plat bien isolé, les aliments continuent de cuire doucement en utilisant la chaleur résiduelle emprisonnée.
Cette méthode permet de maintenir une température de cuisson relativement constante pendant une longue période sans avoir besoin de maintenir une source de chaleur externe allumée.
Pour la durée de cuisson, les aliments sont laissés dans la marmite norvégienne généralement entre 15 minutes (pour du riz par exemple) et 8 heures (pour un plat mijoté comme un boeuf bourguignon).
Ce temps de cuisson sera donc à déterminer en fonction de la recette et de la quantité d’aliments préparés.
Pendant ce temps, les saveurs se mélangent, les aliments deviennent tendres et la cuisson est achevée.
5 — Se régaler :
En fin de cuisson, vous n’avez plus qu’à vous régaler et profiter des bienfaits de cette cuisson douce, plus saine et plus goûteuse !

Pour monter votre plat à la température souhaitée, il est bon de monter la température progressivement dans votre plat au lieu d’utiliser une bouilloire pour atteindre plus rapidement l’ébullition.
En effet, la chaleur a un temps de pénétration dans l’aliment : si ce temps n’est pas respecté, vous n’aurez pas une montée à température homogène et vous aurez des aliments pour lesquels la cuisson à cœur ne sera pas bonne ou plus lente.
Cela se voit particulièrement pour la cuisson de produits volumineux comme de grosses pommes de terre en chemise ou une pièce de viande de taille importante.
Il est essentiel que ces « gros » produits soient immergés au moins à 80 % et montés à température à feux doux ou moyen (et non à feu vif) afin de bénéficier d’une montée à température à cœur correcte et une cuisson réussie.
Il est aussi possible de couper ces aliments volumineux pour les cuire avec plus de facilité.
En principe, il y en aura autant que l’imagination et les moyens du bord le permettent.
Vu que c’est un contenant isolant, cela peut prendre des formes très diverses selon ce qu’on a sous la main et si on est bricoleur(se) ou non.
Cependant, les formes les plus rencontrées sont :

C’est du Lowtech, donc, tout le monde peut en fabriquer une : certains recycleront de vieux duvets ou couvertures en laines, d’autres fabriqueront des caissons solides…
On peut donc en fabriquer de façon très simple comme on peut se lancer dans des bricolages plus sophistiqués.
La difficulté ici réside surtout dans le fait de bien connaître la résistance thermique des matériaux utilisés pour la fabrication de votre propre cuiseur inertiel passif.
Plus ces matériaux auront une bonne résistance thermique (capacité d’un isolant à résister aux variations de chaleur), meilleure sera la qualité de l’isolation de laquelle dépend directement la réussite de vos cuissons en marmite norvégienne.
De nombreux plats dont vous vous servez sans doute déjà au quotidien dans votre cuisine peuvent être utilisés pour cuisiner en marmite norvégienne !
En fait, tout plat avec un couvercle adapté pourra convenir.
Le fait de choisir un plat avec un couvercle bien ajusté permet de minimiser les dégagements de vapeur une fois celui-ci placé dans le cuiseur inertiel passif.
Cela contribue à garder la température constante.
Marmite ou cocotte en fonte, casserole en inox, plat en terre cuite ou en verre sont des récipients idéaux pour la cuisine qui conviendront parfaitement pour une cuisson en marmite norvégienne.

Si vous n’avez pas encore de contenant adapté, sachez que la qualité du produit que vous utilisez pour cuisiner est très importante dans la réussite de votre plat.
Il est souvent plus intéressant et rentable à long terme d’investir dans un plat de qualité.
Même s’il semble cher à l’achat, vous le garderez bien souvent pour toute la vie et il vous permettra d’effectuer des cuissons de grande qualité contrairement à un contenant « pas cher » au départ, mais qui se dégradera vite et qu’il faudra remplacer après quelques années.
Les recettes possibles en marmite norvégienne sont très nombreuses et vous pourrez même en inventer à votre guise, qu’il s’agisse de cuissons longues ou courtes !
Ce qui sera commun à toutes les recettes que vous pourrez faire en marmite norvégienne, c’est qu’elles nécessitent une base d’eau ou tout du moins de liquide dans le plat au départ, sans forcément que ce liquide ne recouvre tout. Cela dépendra des aliments cuisinés.
C’est ainsi l’inertie thermique de l’eau ou du liquide qui permet la cuisson douce dans la marmite norvégienne.
Pour vous donner des idées, voici une petite liste, non exhaustive, de recettes que l’on peut aisément cuisiner en cuiseur inertiel passif :
Découvrez dans la vidéo présente en haut de cette page, un exemple de recette facile à faire en Cuiseur Inertiel Passif. Adrien et Christophe y préparent des pavés de saumon et riz à la crème de champignons en vous détaillant tous les ingrédients et les étapes de cette recette délicieuse !

Si cuisiner un plat entier en une seule préparation est pratique, il est aussi possible de cuire plein d’aliments individuellement.
Oui, c’est un mode de cuisson compatible avec la cuisson vapeur.
Une marguerite de cuisine sera nécessaire et cela fonctionnera à condition d’avoir un bon niveau d’eau en dessous dans votre plat pour permettre l’inertie.
Avec cette méthode en cuiseur inertiel passif, le temps de cuisson sera cependant plus long que la méthode classique de cuisson vapeur mais c’est plus économique !
La marmite norvégienne a de nombreux intérêts, mais, pour nous, il y en a trois principaux :


Les prix d’achat pour une marmite norvégienne varient selon le modèle et le fabricant.
Les marmites norvégiennes peuvent coûter entre 90 et 400 euros et toutes ne se valent pas !
Pour faire votre choix, il nous semble important de se renseigner sur les origines des matériaux utilisés pour sa fabrication ainsi que sur ses modes de production.
Certaines peuvent, en effet, être fabriquées à l’autre bout du monde, dans des conditions peu avantageuses pour les travailleurs et avec des matériaux non adaptés comme du polyester.
Vous pouvez faire vos propres recherches de fournisseurs, si vous le souhaitez.
Pour notre part, plus besoin de chercher, nous avons trouvé le fournisseur qui répond à tous nos critères de qualité !
Il s’agit de l’entreprise Fons Amoris (source d’amour) développée par Adrien que vous avez découvert dans notre vidéo un peu plus haut.

Pour commencer parce que c’est une petite entreprise française dont les valeurs humaines nous parlent.
Nous apprécions notamment :

Mais nous choisissons aussi les marmites norvégiennes Fons Amoris parce que, pour leur confection :
Nous espérons que cet article et sa vidéo vous auront donné envie de vous mettre à la cuisson douce à basse température !
N’hésitez pas à nous partager vos avis et expériences à ce sujet en commentaire !

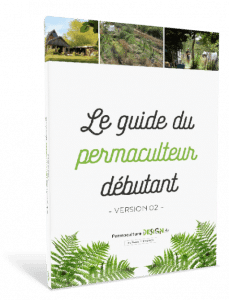
Ne ratez plus aucun de nos contenus et recevez « Le guide du permaculteur débutant »
L’article La marmite norvégienne, une cuisson saine et très économique est apparu en premier sur Permaculture Design.
Permaculture Design, 30/09/2023 | Source: PermacultureDesign

Spécialiste de la culture multi-étagée en climat tempéré, Franck Nathié mène des recherches sur les synergies végétales et le jardin-forêt productif depuis plus de 20 ans.
Fondateur de l’association La forêt Nourricière, designer, formateur et auteur, Franck Nathié a publié 6 livres de référence en permaculture qui ont notamment inspiré la ferme du Bec Hellouin et ses fondateurs.
Fort d’une grande expérience de terrain au cours de laquelle il a appris à « rater joyeusement » tout en affutant ses connaissances du vivant et des écosystèmes, Franck Nathié a à cœur de transmettre ses différents savoirs pour aider toutes celles et ceux qui le souhaitent à incarner le changement qu’ils veulent voir émerger dans notre société.
À travers ses différents ouvrages, les activités de son association et sa chaine YouTube contenant plus d’une centaine de vidéos, Franck Nathié partage une approche unique du jardin-forêt et de la culture multi-étagée où la question de l’autonomie alimentaire avec de récoltes vraiment valorisables dans nos assiettes est prépondérante.
Nous apprécions tout particulièrement le travail de Franck, c’est pourquoi nous nous sommes associés à lui pour créer ensemble une formation en ligne sur le micro jardin-forêt productif dans l’idée de permettre à toutes et à tous, même sans connaissances de départ, de produire ses fruits et légumes sans effort (de 10 à 25 kg par m² cultivé).


C’est possible grâce au micro jardin-forêt productif même sur un petit espace…
Réussir ses semis est en fait un extrait d’un livre plus complet de Franck Nathié intitulé « Multiplication — Taille & Ressources variétales ».
Il a la particularité de se focaliser sur les semis et de synthétiser, dans un petit fascicule de 26 pages, tout ce qu’il y a à savoir pour vous permettre de les réussir qu’il s’agisse de semis de légumes, de petits fruits ou d’arbres fruitiers.
La première moitié du livre est consacrée à la compréhension de ce qui fait la réussite d’un semis (et tout ce qui peut le faire échouer) : les types de graines, leur fonctionnement dans la nature, les différents facteurs de germination, de levée de dormance, l’importance du substrat, de la vernalisation…
Cette première partie est extrêmement éclairante pour enfin comprendre pourquoi on a pu avoir des échecs sur tel ou tel semis et corriger le tir lors des prochains essais 😉 !
La seconde moitié du fascicule est construite sous forme de tableaux de semis avec un premier tableau dédié aux fruitiers (arbres, arbustes et petits fruits) et un autre dédié aux légumes (annuels et vivaces).
On retrouve, dans chaque tableau, le nom du végétal, des observations sur celui-ci, des précisions sur ses conditions de levée de dormance naturelle et les différentes actions à effectuer pour en réussir le semis.
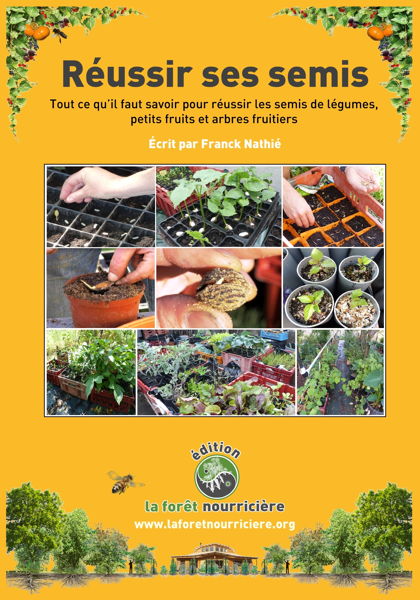
Bon jardinage permacole à toutes et à tous ! 👋
Conçu comme un livre de terrain, à emporter avec soi au jardin, les pages, reliées par une spirale métallique, sont épaisses et entièrement plastifiées pour ne pas craindre l’humidité !
Selon nous, il s’agit là d’un condensé de connaissances indispensables à avoir pour quiconque veut effectuer soi-même ses semis au potager comme au jardin-forêt avec un maximum de réussite.
C’est donc un petit fascicule à mettre entre toutes les mains voulant se mettre dans la terre qui a l’immense mérite d’aider aussi à la compréhension plus globale de la nature et du vivant en nous faisant comprendre pourquoi en agissant de telle ou telle façon, on réussira son semis d’arbre, d’arbuste ou de légume…
Si vous souhaitez vous lancer concrètement au jardin et avoir tous les atouts en main pour réussir, ce livre sera idéalement complété par le calendrier perpétuel du jardin-forêt et potager productif en permaculture réalisé, lui aussi par Franck Nathié, pour vous faciliter encore plus la planification mensuelle de vos actions au jardin (semis, mais aussi plantation, repiquage, entretiens, soins, etc.) !


Découvrez le calendrier perpétuel du jardin-forêt et du potager permacole, un formidable outil pour faciliter votre planification mensuelle.
L’article Livre Réussir ses semis est apparu en premier sur Permaculture Design.
floflo, 11/07/2023 | Source: Brin de paille
 Une dizaine de membres de Brin de Paille se sont retrouvé.es pour avancer sur les différents projets de l’asso ! Site internet, RNP, temps plenière...
Une dizaine de membres de Brin de Paille se sont retrouvé.es pour avancer sur les différents projets de l’asso ! Site internet, RNP, temps plenière... Tags: brin de paille, permaculture, rencontres nationales de permaculture
Tags: brin de paille, permaculture, rencontres nationales de permacultureAdmin, 26/05/2023 | Source: Brin de paille
 Brin de Paille et Le Battement d’Ailes organisent avec vous la 9ème édition des Rencontres Nationales de Permaculture qui auront lieu cet été du 17 au 20 août 2023 !
Brin de Paille et Le Battement d’Ailes organisent avec vous la 9ème édition des Rencontres Nationales de Permaculture qui auront lieu cet été du 17 au 20 août 2023 ! Tags: brin de paille, permaculture, rencontres nationales de permaculture, rnp
Tags: brin de paille, permaculture, rencontres nationales de permaculture, rnp